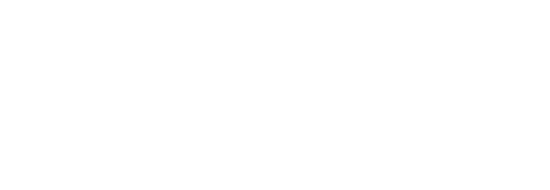Yannis chelabi
Les plus lues
de toujours
Voici ma première œuvre ! Si vous êtes amateur de littérature fantastique j'espère que celle-ci vous plaira. Le bute étant de l'améliorer, j'attends vos commentaires avec impatience. Sur ce bonne lecture !
3
1
133
69
C'est vrai ça ! C'est quoi la mort pour vous ?
Est-ce qu'il s’agit d'un repos éternel, dans un monde utopique, après une vie semée d'embuches ?
Ou plutôt l'arrivée d'un châtiment divin afin d'expier ses fautes ?
Ou, tout simplement, un arrêt des fonctions cérébrales et corporelles ?
Honnêtement je n'en ai aucune idée, mais, en tant que musulman, on m'a instruit qu'il s'agit d'un mélange des deux premières possibilités. Cependant, lorsque l'on évoque la mort dans une discussion, j'ai tendance à imaginer qu'il s'agit surtout d'un moment où l'homme ne se pose plus de problèmes ni aucune limite. Pour moi il s’agit d'un moment où, peu importe le nombre d'erreurs que l'on a commis, plus personne ne peut nous arrêter. Nous sommes alors à l'apogée de notre existence. Mais bon, ça c'est la vision poétique de la mort, car, si l'on se concentre sur une vision plus réaliste, je dirais que la mort se résume souvent à une nuque brisée sur le coin d'une table IKEA ou à une balle de 7,62X39 entre les deux yeux, pour les moins chanceux.
Vous savez, parfois, pendant la nuit aux alentours de 3h du matin, je pense à mon futur et me dis la chose suivante : "c'est dingue de vouloir en savoir tant sur son futur mais de pas être foutu de rattraper ses erreurs du passé."
Dites-moi ! vous pensez que c'est normal de penser comme ça ? Je pense que oui, ou plutôt j'essaye de me rassurer en me disant que oui. Et vu à quoi ressemble les pensées des personnes dites "normal" je pense que c'est bien mieux de penser comme moi.
hum... désolé cette dernière ligne était un peu mal placé.
2
2
11
1
Ce texte n'est que le fruit d'une réflexion personnel. Il représente la majorité des cas que j'ai observé et des cas différents existent bien évidement. Si vous avez une remarque, une reproche ou une insulte, l'espace commentaire est fait pour ça ! ;-)
0
3
0
2
Le tatouage est sans doute la forme d'art, qui joint la plume et le corps, la plus répandu à travers le temps et l'espace. Au-delà des frontières entre époques et contrées, il se fond dans notre quotidien et attire, à de rares instant, notre attention. Pourtant, ses significations peuvent être multiples et ses variations culturelles, elles, sont infinies. Simple effet de mode ou marque d'autorité, gratification ou appartenance à un clan.
En étudiant les peuples des îles du pacifique et plus précisément les polynésiens, on apprends que l'usage du tatouage est bien de marqué la dominance ou la soumission, face aux individus d'une même tribu. On observe, notamment chez les Maori, une différence concernant la manière d'être tatoué, selon la place que l'on se fait au sein du groupe. Les membres inférieurs ne possédant aucunes marques d'encre pouvait se voir interdire l'accès à la nourriture, tandis que les chef mâles et femelles, tatoués et ayant prouvé leurs valeurs, ont un accès prioritaire à la calorie.
Au japon, jusqu'à notre époque, les clans Yakuza pratiquent l'irezumi. Une pratique devenue l'étendard de ceux qui ont lâchement abandonné leur place au sein de la société, pour rejoindre la pègre. L'irezumi n'est pas tout à fait une marque d'autorité, mais bien celle de l'appartenance au groupe. Complété par des règles de vie avant de l'obtenir, il devient alors une gratification octroyer après décisions de l'Oyabun, le chef de famille.
L'humain étant un animale sociable, il est indissociable de la vie en groupe. Sa survie dépend de ses expériences acquises et du savoir-faire qu'il obtient tout au long de sa vie. Nos ancêtres ont très vite compris que la meilleure façon d'économiser du temps et des ressources vitales était, évidement, de joindre les forces de plusieurs individus. De là est née la confiance, le besoin d'une cohabitation, le ressentit d'appartenance à un groupe et par conséquent la marque d'identification d'un individu. Le tatouage est un exemple parfait de ce comportement. D'une simplicité déconcertante, il permet l'identification d'un membre du clan de façon permanente et indélébile, jusqu'à sa mort.
0
0
0
1
Découvertes :
L’évolution positive du groupe (de sa situation calorique par exemple) ne peut être engendré que par la prise de conscience d’un individu. Celui-ci questionne son environnement et par la découverte, souvent dû au hasard, d’un mécanisme physique ou métaphysique, se permet d’améliorer son niveau de vie ; J’entends par là, qu’il l’utilise pour faciliter sa quête calorique et sexuel. Si cette découverte se montre belle et bien bénéfique, l’individu se trouve alors face à deux choix :
-Conserver cette découverte pour lui et ainsi dominer le groupe par ses connaissances supérieures ;
-Ou bien, la propager au sein du groupe pour permettre à ce dernier de s’élever, lui donnant la possibilité d’innover et de s’élever encore plus facilement dans le futur, par la mise au monde de cerveaux plus performants.
Il est alors légitime de se poser une question : “Comment cette décision est-elle influencée ? “.
J’ai donc décidé de poser cette réflexion sur papier pour en exposer les détails. D’abord, j’y décris ce que je pense être la dynamique évolutive qui a favorisé le partage au sein de certaines sociétés. Ensuite, je démontrerais en quoi la confiance est, à mes yeux, le facteur principal influençant les comportements liés au partage et à l’égoïsme.
L’Homme, cet animal social qui partage :
Dans la nature, il est rare de voir des animaux partager directement les ressources caloriques, comme nous le faisons de “mains en mains“. Ils crient et se donnent des coups pour protéger leur nourriture, et ce, même au sein d’un même groupe, entre mâles et femelles. Excepter, pour les femelles qui nourrissent leurs petits. Cela s’explique par le fait que, limiter par leur impossibilité de se projeter dans le futur, la plupart des animaux sont incapables de réfléchir sur le long terme. Si le partage n’est pas vu comme une façon de répondre à un besoin direct, cette option tend à être ignorée par les individus composant le groupe. Seule exception faite pour le nourrissage des petits, cela étant nécessaire à la survie du groupe et inscris dans le code génétique de presque toutes les espèces composant le vivant.
Notre ancêtre, qui a libéré ses membres supérieurs grâce à la bipédie totale a aussi, comme l’explique Frédéric Delavier, apprit à développer des idées sur le long terme par la projection dans le futur. Cette projection est effectuée par un simple mouvement de doigt ; Montrer devant soi pour dire “où je vais“ et derrière pour dire “d’où je viens“.
Plus tard, ayant évoluer de façon à développer des idées et sentiments complexes et à les exprimer par la parole, l’Homme a aussi appris à développer des liens particuliers, comme l’amitié ou l’amour (celui-ci pouvant familial ou sexuel), l’incitant parfois à agir contrairement à toutes les règles de survie. Comme sacrifier ses ressources caloriques, tout en croyant simplement à un hypothétique retour sur investissement. “Elle m’a trompé“ ou “Il m’a trahi“ et les plaintes qui s’en suivent, ne sont que le reflet de notre regret face au sacrifice calorique que l’on s’ait infligé, pour faire naître la confiance puis l’amitié ou l’amour.
Car l’homme est toujours ce même animal ayant pour objectif la survie, il ne donne jamais gratuitement. Le partage, inscris dans notre génétique, quel qu’il soit, est toujours issus d’une attente, directe ou indirecte, à court ou long terme. L’altruisme n’est qu’un phénomène témoignant un intérêt individuel indirect. Maintenant que j’ai répondu à la question du développement de ce phénomène, il est temps de se reconcentrer sur notre première question.
La confiance
Là ou certains affirmerais que ce sont les facteurs sociaux qui influencent la décision du partage, je dis oui et non. Nous allons voir pourquoi.
C’est en tout cas l’un d’entre eux en particulier qui, par les liens qu’il crée, peut provoquer le chaos ou l’évolution positive d’une société. Ce facteur, c’est la confiance.
En effet, plus la confiance règne, plus l’individu sera enclin à partager sa découverte et ses ressources énergique, sachant que cela lui sera tout aussi bénéfique qu’à son groupe. Ce phénomène, comme l’explique Jordan Peterson, peut être observer dans des pays comme le japon ou même la chine, sociétés où les actions en faveur du groupe sont encouragées car elles contribuent à faire évoluer la société. D’abord en partageant les ressources et en rappelant à chacun que leurs actions sont bénéfiques autant à eux qu’au groupe car il y a retour sur investissement.
Dans ce cas, la courbe d’évolution de la situation calorique du groupe change proportionnellement à celle de l’individu, lui-même ayant toujours de l’avance car étant celui qui découvre puis qui transmet.
A l’inverse, dans certains pays où la confiance n’est pas commune à la majorité de la population (comme en Afrique ou en Amérique Latine), c’est en générale un petit groupe d’ultra riches (famille ou amis) régnant sur une masse d’ultra pauvres. Et ce, contrairement aux pays cités précédemment, où les classes sociales sont plus diverses, dû à un partage des richesses plus équitable et basée sur le mérite. Dans les dictatures africaines, le mérite n’a aucune réelle valeur. C’est le lien entre ultra riche qui les incite à ne pas se trahir. Dans ces cas, la corruption et les taxations abusives sont objets courants.
On observe alors un déséquilibrage entre l’évolution du niveau de vie de l’individu et celui de la société. Plus l’individu s’enrichie par l’assimilation de mécanismes, plus son règne devient lourd à supporter pour le reste du groupe, qui s’appauvrie ou se révolte tôt ou tard.
Conclusion :
Pour conclure cet essai ou cette dissertation, peut-importe comment les “académiciens“ sans colonne vertébrale qualifieront mon texte, je tiens à dire qu’il n’y a pas, de nos jours, une bonne et une mauvaise décision quand il s’agit de partager. Pour deux raisons en fait ;
L’une étant que, contrairement à nos ancêtres, nous vivons aujourd’hui dans l’abondance caloriques. Abondance qui est, dans nos sociétés occidentales, atteignable pour la grande majorité des individus. Il est donc légitime de penser que le partage n’a plus la même valeur. Est-ce que cela signifie qu’il est désormais obsolète ? Non. Le partage, qui est inscris dans notre génétique, s’est vu conserver car il est, je pense, le symbole de la confiance entre individus.
L’autre est que, encore une foi, contrairement à nos ancêtres, la taille de nos civilisations s’est développée de façon exponentielle. De façon qu’un petit groupe (comme en Afrique par exemple) se permette de garder pour eux la majorité des ressources. Comme la population est grande et le groupe d’ultra riches très soudé, la sélection naturelle étant ce qu’elle est, ce sont les plus forts et dominant qui survive, sans qu’il n’y ait de répercussions sur celui-ci.
2
1
0
5
Vous êtes arrivé à la fin