Extrait 1
Le néant laissait de la place tout de même pour un peu du monde extérieur pourvu qu’il fût une extension du personnage et de son palais ; le village de Breuilly dans l’Eure, à quarante kilomètres de Pontaix, réunissait les critères clefs ; l’endroit était désert en dehors de l’été – et l’été, il était pénible de circuler – mais convenablement coloré toute l’année grâce aux poutres de ses vieilles bâtisses et leurs teintes vives et les arbres centenaires, majoritairement des résineux aux épines bleutées et les floraisons des plates-bandes et parterres gérées par la commune et les potées des résidents, la profusion en ce sens d’essences persistantes pour ne rien concéder à l’hiver. Breuilly n’était pas un grand village par ailleurs, à deux exceptions l’on pouvait embrasser la totalité des lieux en se plaçant en son cœur, matérialisé par une église rigoureusement entretenue ; la première exception était une rue, disons plutôt une route qui montait et serpentait vers une forêt dense ; il était plus confortable de se garer sur cette route en période touristique et la marche jusqu’au village, de quelques minutes, offrait un point de vue conjoint sur les kilomètres alentours et verts et sur les résidences arborées, paysagées, riches. La seconde exception était une abbaye que l’on pouvait bien totalement manquer en sautant une ou deux rues, précisément parce que les rues, lors, se raréfiaient, présage habituel de l’effacement d’un village au profit de ses prés ; point de prés ici mais un grand jardin qui servait l’été aux iconiques foires à tout, quelques derniers bâtiments où boire du cidre ou manger une crêpe, un pin gigantesque pour masquer l’horizon proche, et l’illusion était jouée. Passés le jardin et ses nombreux bancs, ses potées géantes de pétunias et de santolines, l’on parvenait à une grande porte en pierre, celle du site de l’abbaye, et la promenade prenait une tournure nouvelle. L’endroit était principalement blanc, la pierre des moindres constructions, la terre, le ciel par-dessus ; le contraste était assuré par plusieurs bandes d’herbes, un vieux et grand laurier, une rangée de platanes déformés et un ruisseau, faible et qui circulait sous l’abbaye. Le site était ancien d’un millénaire et disposait de plusieurs bâtiments : l’abbaye donc, partiellement détruite et dont persistaient quelques traces au sol, quelques rocs épars ; une chapelle, plus à l’écart ; une ancienne écurie qui servait à l’accueil des visiteurs et aux expositions ; une maison des hôtes enfin, recouverte de lierre et où se recueillir, être entendu, faire halte ou retraite, selon. Les balades du personnage à Breuilly commençaient toujours par les rues et ruelles d’odeurs et de couleurs du village pour se terminer par la quiétude de l’abbaye ; il y avait à s’arrêter entre la circonférence des arbres, l’écoulement frêle du ruisseau et la conservation des constructions les plus anciennes. Sur les questions architecturales, Golan composait avec une ignorance assumée bien que regrettée – peut-être tenait-il une source prochaine d’obsession ? – et il lui fallait forcer sur son intuition comme on force sur un muscle. Ce jour, la visite du personnage était brouillonne ; il s’arrêtait bien sur les détails habituels, certes ses yeux se posaient sur les tuméfactions des platanes, ses pieds ne bougeaient plus, la mécanique était huilée, mais ses pensées allaient sans crampons ; il mâchait et remâchait, animal nietzschéen, les enseignements de ses récentes lectures ; le personnage s’était plongé longuement dans les biographies de Machen, choisissant de les lire en même temps, découpant les périodes en s’appuyant sur les sommaires, passant du français à l’anglais non sans quelque aide de ses dictionnaires et des ordinateurs de la bibliothèque de Pontaix. Il s’était arrêté à l’histoire du jeune Machen, enfant de la campagne, des sentiers, collines, enfant des espaces ; les biographes étalaient le vert à coups de digitales, genêts et autres fougères, les forts romains étaient gardés par des cercles de chênes, les orties, les ormes et les hêtres. L’herbe était grasse. Les rêves d’Arthur Machen s’étaient formés là, gonflés par la moisissure, les regards et les jambes toujours portés vers les bosquets et les forêts. Golan s’était assis au pied du laurier, jeta un regard vers le couple de retraités qui s’apprêtaient à le longer, et les biographies disaient par ailleurs la défiance de Machen pour l’école ; le gallois préférait la solitude à ses camarades, ils n’avaient rien en commun, eux n’avaient pas la forêt, ni les ruines romaines ; l’école, disaient les biographes, lui était un interlude, l’encéphalogramme plat jusqu’aux vallées de son amour ; le personnage traduit approximativement cette phrase : « comme un homme qui retourne à ses êtres chers et sa terre natale après un exil parmi les étrangers. »
Arthur Machen devait composer avec une mère invalide. Il lisait Nicolas Flamel. Il apprenait le français grâce à un maître qu’il affectionnait ; les données affluaient sans que le personnage fût en mesure de les trier. Les éléments les plus insignifiants ne l’étaient pas. Une chose semblait acquise : la rencontre de Machen et du mysticisme – exception faite de l’étrangeté propre à Caerleon, ville natale de l’auteur et siège prétendu de la cour du roi Arthur rappelons-le – eut pour théâtre la bibliothèque de son père. L’obsession du jeune Machen pour le bizarre était palpable ; le Machen étudiant, exilé à Londres et dans la continuité de sa scolarité, ne sociabilisa pas, se tournant encore vers la solitude et la garde jalouse de son monde surnaturel, son corps arc-bouté sur l’étendue planétaire mais intérieure, et l’écho était saisissant pour le personnage sis dans le village de Breuilly et ses pas, dans le village et parmi l’abbaye, qui refusaient, tus qu’ils étaient, de confirmer l’existence de quoi que ce fût : un mur sur quoi se répercuter, un amas de cailloux, la brise, un être de chair et de sang.
Mais où se situait Golan – demandé-je comme pour marquer une pause – du point de vue de la religion et lors que les oripeaux du christianisme se tenaient là, en refus des prises des vents et des temps ? Il n’y avait pas de réponses hormis une certaine opacité qui s’accrochait tant au discours qu’en son intérieur ; le personnage ne savait pas, ce fut évoqué lors des toutes premières lignes, il souhaitait savoir, et une fois ceci dit, c’était tout ; il voulait bien écouter les prêches, les philosophes et les scientifiques, mais il manquait chaque fois quelque chose. Il y avait eu Kierkegaard et le terme d’angoisse, et le personnage fut conquis : oui le vertige d’exister, oui la nausée du choix. Kierkegaard le tenait, il y avait l’émotion d’être entendu ; il fallait approfondir ; il était question de la douleur, sa reconnaissance, et n’y était-il pas déjà ? C’était là, tout était écrit, il poursuivit ; et de chuter devant le concept de vérité, la vérité subjective de Kierkegaard, c’était déjà beaucoup demander, prise littéralement, mais ce que voulait dire le philosophe, c’était que la vérité devait être décidée, assumée, incarnée, mais selon quels critères, quelle intuition, quel tuteur ? Quel égarement ! Et la foi et Kierkegaard ? Jette-toi encore, Golan, ne passe pas par les entrelacs de la réflexion – le philosophe le disait lui-même ! – mais décide de ta foi. Le personnage en était resté terrifié, et là était-il encore, muet, à quelques pas d’une brèche infranchissable en l’état.
La famille Machen était pauvre en dépit des livres ; le père était en banqueroute ; le jeune Machen multipliait les emplois hasardeux, il enseignait les mathématiques – qu’il détestait par ailleurs ; il ne parvenait pas à se fixer et ne parvenait pas à fixer son écriture ; avant les pastiches, avant d’être un excellent imitateur, Arthur Machen se limitait à de petites flammèches créatives. Les balbutiements littéraires du gallois étaient, pour Golan, un encouragement : si Machen avait peiné, le personnage pouvait peiner et réussir à écrire ! Il se déplaçait depuis peu avec un carnet acquis pour presque rien qui réceptionnait ses pensées et ses idées et ses moindres tentatives et dans des formes variées puisqu’il s’essayait aux poèmes, donc, mais de même à la fiction, et parmi la fiction, à la littérature dite blanche comme à celles de l’imaginaire. Le souffle de son écriture était un peu court, ce qui le rapprochait de Machen, et il raturait beaucoup, arrachait parfois. Franz Kafka écrivait quotidiennement pour établir une hygiène de l’écriture ; c’était un leitmotiv et il souhaitait s’y tenir, mais il était rattrapé par ses réticences et l’agacement qui le prenait à la lecture de ses dernières créations. Alors il repensait à Machen et pensait à ce talent d’imitateur qu’il ne partageait absolument pas avec lui ; alors ils n’avaient plus rien en commun, il n’y avait aucun espoir, et la consternation, pour quelques heures, jours, refermait son carnet.
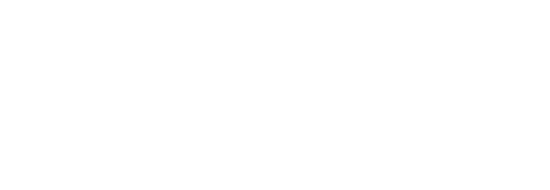
Annotations
Versions