Façon de voir le monde
Comme toute activité artistique, elle est la manifestation d’une façon de voir le monde, de s’y inscrire selon une perspective qui est toujours singulière. On ne peut ainsi poursuivre une œuvre qui envahit la totalité de l’espace d’une vie, sans que cette dernière ne trace, dans le massif de l’exister, le motif d’une nécessité. On ne peut poursuivre l’écriture des quelque 17000 pages d’un « Journal intime » à la Amiel, pas plus qu’on ne peut consacrer l’entièreté de son horizon à tracer boucles, pleins et déliés sans que quelque signification en profondeur n’atteigne ces tâches au long cours. Beaucoup n’y verront que la partie émergée d’une obsession, d’autres s’inclineront devant la vastitude de l’entreprise. En sa constitution, le monde est infiniment varié, tu me l’accorderas Solveig.
Je te sais si obstinée à poursuivre ton travail sur le langage – tu n’as pas été professeur de littérature française à l’université pour rien -, raison pour laquelle je continue à dérouler mon fil, du moins tant que la pelote se dévide et ne trouve sa fin. Sans doute comprendras-tu le besoin de m’interroger encore et encore sur la nature du geste qui me pousse à remplir cahiers après cahiers, un travail obstiné de fourmi que, sans doute, ne comprendront que ceux qui en ont éprouvé, au fond d’eux-mêmes, l’irrésistible force d’aimantation. Parfois, hésitant sur une formule, sur la qualité d’une énonciation, suspendant mon écriture, je pense au destin de ces grands auteurs qui ont semé sur leur chemin littéraire de si beaux jalons. Chacun qui écrit a toujours ce souci en soi de mettre son travail en perspective, de lui trouver des échos dont nos aînés auraient parsemé leurs œuvres, tels des exemples à méditer. Vois-tu, en un premier motif je pense à cette puissance intemporelle des textes majeurs. Mais à trop les inscrire dans son champ de vision et l’on renoncerait à toute tentative d’écrire une seule ligne. Je crois qu’il faut soi-même écrire sur fond de ce murmure, laissant venir à soi, à la manière d’un songe, quelque pièce d’anthologie inscrite au fronton de l’humanité.
Intemporel, disais-je, et tu me permettras de citer quelques noms dont je sais qu’ils te sont familiers. Intemporel Hölderlin lorsque son biographe, Wilhem Waiblinger écrit dans « Vie, poésie et folie de Friedrich Hölderlin » :
« Dans les débuts, il écrivait beaucoup et couvrait tous les papiers qui lui tombaient sous la main. C’étaient des lettres en prose ou en vers pindariques libres, toujours adressés à la fidèle Diotima, et fréquemment aussi des odes en vers alcaïques. Il avait adopté un style tout à fait singulier. Le contenu : souvenir du passé, combat avec Dieu, célébration des Grecs. »
Oui, combien la vision de Hölderlin était vaste, combien son amour pour Diotima (Suzette Gontard dans le réel, qu’il sublima dans « Hypérion » sous la figure de Diotima) était émouvant, la perte de cet amour étant constitutif de sa chute dans l’abîme de la folie. Si le sort avait décidé de me doter d’une écriture de plus grande ampleur, nul doute, Solveig, tu eusses rempli ce merveilleux rôle de Diotima, cette aimée qui se retire dans un impossible amour. Mais tu le sais, tout comme je le sais, tout amour par nature est impossible, seulement son hallucination, seulement sa projection dans le poème ou dans la figure de l’art, ce qui, somme toute, revient à dire la même chose.
Intemporel, Rainer Maria Rilke avec son somptueux poème que, nécessairement, tu connais par cœur :
« Pour écrire un seul vers
Il faut avoir vu beaucoup de villes
D'hommes et de choses
Il faut connaître les animaux
Il faut sentir comment volent les oiseaux
Savoir quel mouvement font les petites fleurs en s'ouvrant le matin.
Il faut pouvoir repenser à des chemins dans des régions inconnues
À des rencontres inattendues
À des départs que l'on voyait longtemps approcher
À des jours d'enfance dont le mystère ne s'est pas encore éclairci… »
Il serait tentant de commenter mais à quoi donc servirait-il de rajouter des mots à la pure splendeur ? Le poète, le véritable poète est en dehors de la commune mesure, tel l’aigle royal il vole à des altitudes dont nous, simples mortels, avons du mal à imaginer qu’elles puissent exister, et ces « chemins dans des régions inconnues », même nos rêves les plus insensés n’en pourraient rejoindre le sublime tracé. Il nous suffit de lever nos yeux au ciel et de questionner ce qui n’a nulle limite, à savoir les mots, ces « petites fleurs qui s’ouvrent au matin ».
Intemporelles les formules décisives de Novalis dans « Monologue » :
« De même en va-t-il également du langage : seul celui qui a le sentiment profond de la langue, qui la sent dans son application, son délié, son rythme, son esprit musical ; - seul celui qui l’entend dans sa nature intérieure et saisit en soi son mouvement intime et subtil pour, d’après lui, commander à sa plume ou à sa langue et les laisser aller : oui, celui-là seul est prophète. »
Vocation prophétique du Poète qui rejoint la sublime intuition rimbaldienne :
« Je dis qu’il faut être voyant, se faire voyant. Le Poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d’amour, de souffrance, de folie ; il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons, pour n’en garder que les quintessences. »
Prophétie, voyance, poison, folie, tels sont les ingrédients universels du langage en son incandescence lorsqu’il se fait pure poésie. Alors, Solveig, comment envier le destin du poète si ce n’est à sombrer hors du monde dans d’insondables abysses ?
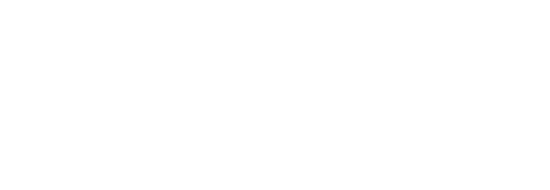
Annotations
Versions