Pourquoi écrivez-vous ?
« Pourquoi écrivez-vous ? », question récurrente s’il en est. Comme si le fait d’écrire découlait de la pure énigme. S’interroge-t-on sur quelqu’un qui jardine, qui bricole, qui pêche à la ligne ? Oui, Sol, j’en conviens, le geste d’écrire est d’une autre nature. Le geste simplement graphique, écrire une lettre, s’inscrit dans le quotidien. Ecrire des fictions, émettre des idées s’apparente bien plus à une tâche artistique, or l’Artiste, de tout temps, a été considéré comme une espèce à part du monde, comme une activité subversive identique aux manipulations alchimiques dans l’atmosphère trouble de quelque laboratoire. Jean-Paul Sartre écrivait dans les salles du « Flore », mais, outre que tout le monde n’est Sartre, l’auteur de « L’Être et le Néant » était physiquement présent mais son intuition créatrice devait être à mille lieux des autres consommateurs. On n’écrit nullement une œuvre si dense à être un buveur de café ordinaire. Sans doute le génie de Sartre avait-il besoin de cet environnement de ruche discrète pour faire jaillir les mots à la pointe de sa plume !
Donc à la question « Pourquoi écrivez-vous ? », soit je répondrai par une autre question :« Pourquoi aimez-vous ? » soit : « J’écris pour écrire », autrement dit d’une manière plus simple, « j’écris pour rien » Ecrivant pour rien signifierait-il écrire pour une sorte de néant, de silence de la page blanche, de vide que l’on essaie de combler, mais jamais un vide existentiel ne se comble, jamais il ne peut être saturé, pour cette raison la tâche d’écriture est infinie tout comme le langage est infini qui nous tend l’immense miroitement de son édifice babélien. Tu auras deviné, Solveig, que ma conception de l’écriture se donne sous la figure d’un pur jeu de langage et si tu as pensé ceci, tu es dans le vrai. Jamais l’écriture ne peut se donner sous un quelconque thème axiologique, lequel déterminerait la valeur éminente de la forme ou bien du fond ou bien encore de l’intérêt de la fiction, du caractère des personnages.
L’écriture en tant qu’écriture, voici la seule « justification » possible des signes tracés sur l’aire de la page ou apparaissant sur l’écran de l’ordinateur. L’écriture en tant qu’écriture convoque l’essence, l’intemporel, autrement dit, pour consoner avec quelques réflexions précédentes, rejoindre en quelque manière les belles visions d’un Hölderlin, d’un Rilke, d’un Novalis. Mais, bien évidemment, toute essence s’hypostasie pour chuter dans l’existence et embrasser la temporalité telle que décrite par « La Recherche » proustienne. Sans doute un vers mallarméen (Mallarmé, ce sculpteur de la langue selon son essence), « le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui » contient-il, en substance, la totalité de la signification de l’acte d’écrire : « le vierge » fait signe en direction de l’essence et de l’intemporel, « le vivace et le bel aujourd’hui » appelle l’existence et l’inscription dans la temporalité. Le langage est toujours cette jonglerie, ce travail d’équilibriste entre une poésie transcendante et une prose immanente. C’est à cette tâche qu’elle confie la nature de son être. Bien loin de décrire le réel, c’est le réel qui apparaît, l’essence de la manifestation que le mot, la phrase traduisent.
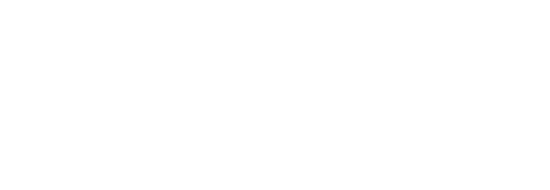
Annotations
Versions