Proust
Alors, maintenant, si à partir de l’intemporalité d’un Hölderlin, de la temporalité d’un Proust, j’amène, dans la plus pure modestie, mes essais d’écriture, que veulent-ils indiquer, en direction de quoi font-ils signe, de quel mince événement sont-ils le témoignage, en un mot, quel est le sens qui les fait se lever, se tenir debout ? Solveig, ton expérience de la vie, tout comme la mienne du reste, est assez avancée pour que tu aies pu jauger les moindres compartiments de l’exister, leur attribuer des prédicats précis, ranger ici un rapide bonheur, là une peine, plus loin un tissu d’ennui et de monotonie sur lequel notre être doit toujours faire fond. Oui la quotidienneté en sa factualité est une entrave à notre propre liberté, un genre de boulet que nous traînons derrière nous avec le cruel sentiment que, jamais, nous ne pourrons en gommer la sournoise présence. Alors créer, poser des mots sur un manuscrit, plaquer des touches de couleur sur une toile, tout ceci se justifie-t-il à la façon d’un rituel, d’un geste d’exorcisme, lequel nous arrachant à notre désarroi constitutionnel, nous allège d’autant, nous porte dans un genre de faveur dont nous souhaitons la constante réactualisation, la reproduction à l’identique le long des jours qui s’enchaînent et, alors, chantent, rayonnent, déploient la pure générosité de leur être. Je crois que mon écriture peut, de cette manière, recevoir un début d’explication. Bien plutôt que de m’inscrire dans l’intemporel (j’en serais bien incapable), de transcender la temporalité (pour moi elle serait hors de portée), j’ai sans doute souhaité m’inscrire dans ce que je pourrais nommer « l’événementiel », des éclairages, chaque jour qui passe, sur le fait littéraire, quelques brèves intuitions philosophiques, des propos sur l’art, des fictions, des considérations qu’il faut bien nommer « métaphysiques » au motif qu’elles portent bien plus sur des idées que sur les actes qu’elles sont censées représenter.
Au début de cet article, je mentionnais le travail quasi quotidien d’un Henri-Frédéric Amiel qui notait des jours durant, jusqu’au petit matin, des milliers de réflexions de tous ordres. Elles étaient un peu comme la nervure autour de laquelle se tissait le limbe de sa propre existence. Activité de diariste qui, en quelque façon, montre la trame d’une vie. Rêvée plutôt que vécue, feront remarquer les plus réalistes. Certainement mais on pourrait leur opposer un facile argument au travers de cette question : « C’est quoi la vie en somme ? Lire, aimer, tailler des arbres, méditer, écrire, édifier un mur de pierres sèches sur le plateau du Causse ? C’est quoi, exister ? » L’on aura compris que nulle réponse n’est satisfaisante en soi, qu’elle est tributaire d’une psyché, d’une expérience, d’un concept et de plein de choses totalement indéfinissables.
Donc la singularité d’un monde-pour-moi. Imagine, chère Solveig, ce qu’a bien pu être pour moi un de ces derniers dimanches d’hiver au travers duquel commençaient à paraître les premiers bourgeonnements du printemps. Imagine deux larges plateaux de pierres blanches, semés des étoiles des genévriers, plateaux que sépare, dans la douceur, une vallée avec quelques rares maisons disséminées ici et là. Le calme dans sa silencieuse venue. Nul mouvement, si ce n'est, parfois, une lame de vent qui court sur le Causse, traverse les branches torturées des chênes, se râpe contre leur écorce rugueuse. Devant moi, tout au bout d’un promontoire, un chemin longe la crête déserte à cette heure. Au sol, parmi des tapis de mouse et de lichen, quelques pierres grises et blanches qui gisent là dans la nudité de leur être. Que faire alors, je te le demande, sinon me saisir de quelques pierres que je dispose les unes sur les autres à la façon d’un cairn ? Oui, je l’avoue, ceci est un jeu d’enfant, mais aussi un jeu d’adulte parvenu à l’automne de sa vie, qui tâche de se distraire comme il peut en façonnant le réel qui lui fait face. Longtemps je suis resté assis à scruter cette élévation subite, à essayer d’en démêler la signification puisque, aussi bien, tout geste s’inscrit-il, nécessairement, dans un projet plus vaste que ne l’évoque sa simple profération. Puis, soudain, l’image s’est annoncée sans aucune anticipation de principe, de la même façon que surgit, chez le jeune enfant, cette interjection qui, pour lui, constitue le terme de son unique vérité. Ce que j’ai vu, voici : mon corps réduit en cendres, répandu sur le blanc des pierres. Une blancheur ossuaire rejoignant une blancheur géologique. Ici, parmi le vent du Causse, ici, dans la vastitude d’une solitude cherchée, je venais d’élever la stèle qui, en un certain sens, annonçait la clôture de mon être, ma dispersion parmi le lacis des chemins blancs qui se perdent au milieu des tapis d’herbe courte et des branches dénudées des genévriers que des hivers successifs ont dépouillés de leur écorce.
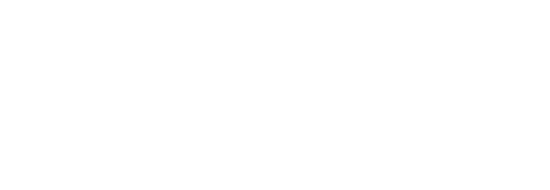
Annotations
Versions