Chapitre 1 : LES PREMIERS CONTACTS AVEC LES PORTUGAIS
En 1483, le royaume Kongo, vaste et puissant, s'étendait dans l'ouest de l'Afrique centrale, bordé par les rivières et les forêts denses. C'était un territoire où la nature se mêlait harmonieusement aux habitations traditionnelles, en bois et en paille, construites autour des cours royales et des villages. Des montagnes au nord aux rives du fleuve Congo au sud, le royaume abritait des peuples différents, unis par une culture commune. Le fleuve Congo, particulièrement, jouait un rôle central : il reliait les communautés, facilitait les échanges et offrait une source de vie et de richesse à ses habitants.
Le royaume était dirigé par le roi ou Manikongo Nzinga Nkuvu, un souverain respecté, sage et fort. Il portait les attributs du pouvoir, une couronne ornée de plumes et des tissus en coton finement tissés. Ses fils, Mpanzu Nzinga et Nzinga a Mvemba, étaient jeunes et pleins d'ambitions, héritiers d'un royaume florissant, mais confrontés à de nouveaux défis extérieurs.
En 1483, un événement marqua un tournant dans l’histoire du royaume Kongo : l'arrivée de l'explorateur portugais, Diego Cao, qui découvrit l’embouchure du fleuve Congo. C'était la première rencontre officielle entre le royaume Kongo et les Portugais. Les Portugais, avides de nouvelles routes commerciales, cherchaient à établir des liens amicaux avec ce royaume puissant. Diego Cao, en naviguant sur les côtes africaines, apporta avec lui des cadeaux et des symboles de la paix. Ses échanges avec le roi Nzinga Nkuvu furent le début d'une amitié nouvelle entre les deux peuples.
Les Portugais offrirent au roi Nzinga Nkuvu un symbole de leur respect : une croix chrétienne, un geste qui allait marquer le début de l'introduction du christianisme dans le royaume. Lors de cet échange, les coutumes et les pratiques des Portugais fascinèrent le roi et ses fils, qui décidèrent de renforcer cette alliance naissante.
Quelques années plus tard, en 1491, une étape importante fut franchie. Le roi Nzinga Nkuvu et son fils Nzinga a Mvemba, après leur conversion au christianisme, adoptèrent des noms portugais. Nzinga Nkuvu devint "João", et son fils Nzinga a Mvemba, surnommé désormais "Afonso". Ce geste symbolique marquait leur nouvelle identité en tant que chrétiens, tout en consolidant l'alliance avec les Portugais. Le royaume Kongo, tout en restant fidèle à ses traditions, s'ouvrait à de nouvelles influences, tout en cherchant à maintenir son pouvoir et son indépendance.
Les conversations entre le roi et ses fils reflétaient un mélange de prudence et d'espoir. Nzinga Nkuvu, bien qu'ayant accepté la religion chrétienne, craignait que l'influence des Portugais ne menace l'autonomie du royaume. Dans ses échanges avec ses fils, il leur conseillait de ne pas se laisser éclipser par cette nouvelle culture.
Nzinga Nkuvu : « Mes fils, ce que nous avons accepté aujourd'hui, ce n'est qu'une étape. Le christianisme peut nous apporter des bénédictions, mais il doit rester un outil pour renforcer notre royaume, pas un maître. Nous devons garder notre dignité et notre pouvoir, tout en naviguant avec sagesse dans ces nouvelles eaux. »
Nzinga a Mvemba (Afonso) : « Tata, Père, je comprends. Mais il est aussi nécessaire que nous forgeons des alliances avec ceux qui sont venus de l'autre côté de la mer. Peut-être pouvons-nous les utiliser à notre avantage pour renforcer le royaume, tout en préservant ce que nous avons construit. »
Mpanzu Nzinga : « C'est une grande responsabilité, Père. Si nous adoptons ce nom, ce symbole, ce n'est pas seulement une question de foi, mais de politique. Il nous faut être vigilants. »
Leurs vêtements, richement décorés de perles et de tissus africains, contrastèrent avec les habits des Portugais. Ces derniers, vêtus de soie et de lin, apportaient une touche étrangère, mais accueillie avec curiosité. Les discussions à la cour royale se déroulaient autour de questions de stratégie, de religion et d'alliance, tout en entretenant une tension palpable, car l'avenir du royaume semblait désormais lié à cette nouvelle dynamique avec les Portugais.
Ainsi, en 1491, le royaume Kongo se retrouvait à un carrefour de son histoire : une rencontre entre tradition et changement, entre l'Afrique et le monde chrétien. Le temps allait révéler comment cette alliance influencerait non seulement le Kongo, mais aussi les événements qui marqueraient l’histoire de l’Afrique centrale.
Version Ex-cursus :
Les habitants du royaume Kongo, habillés de tissus tissés à la main et de peaux d'animaux, portaient des parures faites de perles et de métaux précieux. Les hommes arboraient souvent des pagnes colorés, des coiffures élégantes, et des bijoux en cuivre, tandis que les femmes s'habillaient de robes amples en coton, décorées de motifs symboliques. Leurs peaux noires, luisantes sous le soleil africain, étaient parfois parées de peinture corporelle représentant des signes tribaux et des histoires ancestrales.
À la fin de chaque journée, les hommes et les femmes se retrouvaient autour du feu pour chanter et danser. C’était un moment de communion où les anciens transmettaient les légendes et les savoirs traditionnels, et où les jeunes apprenaient les chants des ancêtres. Ces soirées étaient pleines de vie, mais aussi de sérieux, car c'était ainsi que le peuple restait connecté à son histoire.
La musique qui s'élevait des tambours et des voix battait en écho dans la forêt, tandis que les conversations en Kikongo se mêlaient aux bruits du crépitement du feu. Mais, en ce même moment, loin de cette atmosphère familière, un autre monde se préparait à faire son entrée dans cette terre : celui des Portugais, qui arrivaient, eux aussi, porteurs de leurs propres chants, mais dans une langue incompréhensible. L'incompréhension était profonde, chaque mot échangé semblait être un monde à part. Les Portugais, habillés de soie et de lin, arborant des manteaux et des chapeaux brodés, regardaient curieusement ces hommes et ces femmes, vêtus de manière simple, mais d’une élégance ancestrale. Leurs conversations se faisaient dans un portugais guttural, incompris, mais pourtant porteur de promesses de biens et de pouvoir.
Les premiers contacts se firent dans un contexte de curiosité réciproque. Les Portugais apportaient des tissus, des perles, des armes et des objets brillants, qui attiraient l'attention des Kongolais. Mais ces rencontres ne furent pas sans tension, car la culture était profondément différente, et la présence des étrangers dans le royaume Kongo venait bousculer les pratiques ancestrales.
En 1586, à l'âge de 36 ans, Diego Cao mourut, après avoir marqué son passage par la découverte de l’embouchure du fleuve Congo. Cela restait un tournant dans l'histoire, mais les Portugais restaient des acteurs secondaires aux yeux des Kongolais, dans un royaume toujours imprégné de ses croyances et de son identité culturelle.
Cependant, en 1591, les choses prirent un tournant décisif. Le roi Nzinga Nkuvu et son fils, Nzinga a Mvemba (futur Afonso Ier), avaient accepté le christianisme, suivant la pression des missionnaires catholiques portugais. Ils adoptèrent les noms portugais : João et Afonso. Mais cela ne dura pas longtemps. Les tensions entre la culture chrétienne et la tradition ancestrale étaient trop fortes.
En 1495, Nzinga Nkuvu, le roi, se révolta contre l’imposition de la religion chrétienne. Il chassa les missionnaires catholiques portugais de la capitale Mbanza Kongo. Les chrétiens ne pouvaient accepter la polygamie, ce qui entra en conflit direct avec les pratiques traditionnelles du royaume Kongo. Ce fut le début d’un grand bouleversement, car les croyances religieuses et la politique se mêlaient dans une lutte de pouvoir.
Finalement, Nzinga Nkuvu retourna au culte de ses ancêtres. Mais son fils, Nzinga a Mvemba, qui avait vu l’opportunité dans l’alliance chrétienne, se réfugia chez les Portugais. Il vécut en exil pendant une longue période avec eux, accueillant la culture chrétienne avec un enthousiasme discrètement stratégique. Pendant ce temps, son père mourut, et Nzinga a Mvemba revint au royaume incognito. Le jour même de son retour, il fit tuer son frère, Mpanzu Nzinga, qui avait pris le pouvoir, avec l’aide des Portugais.
Le royaume se retrouva dans une situation étrange. Afonso Ier, désormais roi, imposa le christianisme avec une main de fer. Ceux qui résistaient étaient persécutés. La légende raconte qu'il ordonna la mort de sa propre mère, une figure importante de la tradition Kongo, qui s’entêta, et il fit cela afin de renforcer son pouvoir et sa légitimité. Un royaume autrefois régi par des traditions animistes et des croyances ancestrales était désormais dominé par la croix chrétienne.
Les conversations entre les partisans de la tradition et les partisans du christianisme étaient violentes et empreintes d’émotions fortes. Dans la salle du trône, entouré de ses conseillers portugais, Afonso défendait sa décision.
Afonso Ier (Nzinga a Mvemba) : « C’est ainsi que nous marcherons vers un avenir plus fort, plus uni. Ceux qui n’acceptent pas le messie Jésus devront payer le prix de leur insoumission. Ce royaume doit se purifier. »
Un conseiller portugais : « Vous avez fait le bon choix, Votre Majesté. La foi chrétienne est la voie vers la prospérité. Vous ne pouvez plus vous permettre de laisser ces anciennes pratiques ternir votre royaume. »
Un ancien du peuple Kongo : « Mais le cœur de notre peuple est dans nos ancêtres, dans les esprits de la terre. Comment pouvez-vous renier tout ce que nous avons été pour suivre une foi étrangère ? »
Afonso, les yeux pleins de certitude, répondait : « Ce royaume doit évoluer. Le temps des ancêtres est révolu. Il est temps de bâtir un avenir nouveau. Le Christ nous guidera. »
Les murs de la capitale Mbanza Kongo résonnaient des échos des décisions lourdes et des sacrifices, d’un royaume qui se perdait dans les méandres du changement forcé.
Les habits des Kongolais changeaient aussi. Autrefois vêtus de simples tissus et de peaux d'animaux, beaucoup adoptaient les manteaux des Portugais et les crucifix autour du cou, signes d’une identité en pleine mutation. Pourtant, parmi la population, certains gardaient en secret leurs traditions, dans l’espoir que le royaume, un jour, retrouverait ses racines.
——
*Cet épisode couvre une période allant de 1483 jusqu'à peu après 1506.
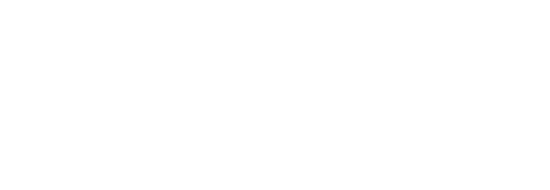
Annotations
Versions