Chapitre 3 : LES CONFLITS
Le Portugal et le royaume du Kongo étaient partenaires commerciaux depuis deux siècles. Cependant, le déclin de l'autorité royale profita aux Portugais qui demandèrent en 1663 les droits miniers des gisements du Kongo. Antonio, qui entretenait de très mauvaises relations avec la couronne portugaise, refusa. Ce prétexte fut alors utilisé pour déclarer la guerre ouverte au Kongo.
Les Portugais et leurs alliés se regroupèrent dans la ville de Luanda. Sous le commandement de Luís Lopes de Sequeira, un soldat métis, les troupes portugaises étaient organisées autour d'un groupe de 450 mousquetaires et deux pièces d'artillerie légères. L'armée du Kongo comprenait de nombreux paysans et archers, mais aussi un régiment de 380 hommes armés de mousquets, dont 29 Portugais dirigés par Pedro Dias de Cabral, également métis. Le roi Antonio emportait avec lui le trésor et les archives de l'Empire, par peur de leur prise par un rival durant son absence.
Antonio déclara à ses lieutenants : « Je suis le roi légitime du Kongo, mais les Portugais veulent imposer leur propre souverain. Nous devons défendre notre royaume. » À l'époque de Vita Nkanga, le Kongo était déjà divisé en plusieurs États indépendants dont certains sous la coupe portugaise (basuku, bayaka, etc.).
Après la bataille, le Roi (ou Manikongo) fut décapité et sa tête fut enterrée par les Portugais dans une chapelle située sur la baie de Luanda au cours d'une cérémonie religieuse, tandis que la couronne et le sceptre du Kongo étaient envoyés à Lisbonne comme trophée. Après la mort du roi et de ses lieutenants, le royaume fut morcelé par la guerre civile du Kongo jusqu'à sa réunification par Pierre IV.
Entre le Portugal et les peuples du Congo-Angola (Kongo - Ndongo), la guerre était inévitable. D’un côté, le Portugal, plein d’ambition, lancé avec fierté à la "découverte" des terres d’outre-mer, avide surtout des énormes ressources de l’Afrique centrale : les métaux, les produits de la terre et, bien sûr, les hommes et les femmes, mis en esclavage et déportés. De l’autre côté, le royaume de Kongo, structure politique complexe, une véritable référence, dotée d’une identité forte et fière de son indépendance. Le 29 octobre 1665, c’est l’affrontement final, voulu par les Kongo, coalisés avec leurs voisins, le Ndongo et le Matamba. Nzinga, reine de Ndongo, déclara à ses alliés : « Nous devons soutenir nos frères du Kongo. Le Portugal menace notre liberté et notre avenir. »
L’aristocrate kongo sera décapitée : une immense défaite, lourde de conséquences politiques et culturelles pour toute l’Afrique centrale. Visite d’un haut-lieu d’histoire et de mémoire africaines.
Mais comment était-il possible que deux siècles auparavant, ces deux civilisations, Kongo et Portugais, étaient en bons termes lors de l’arrivée de Diogo Cão qui a rencontré Nzinga Nkuvu, et que tout bascule ici jusqu'à la guerre ? C’est de cela que nous allons parler dans ce chapitre et le suivant, mais tout d’abord, retournons vraiment au tout début, bien avant 1665.
En 1539, le Manikongo Alphonse 1er a failli être assassiné à l’église un matin de Pâques par les Portugais car il tenait à faire arrêter ce trafic d’humains, vu que l’esclavage noir avait réduit l’effectif Kongo. C’est là que les conflits entre le Kongo et les Portugais ont commencé. Malgré ce conflit, le roi ne s’était pas montré dur contre la religion des blancs, même s’il était en désaccord avec eux. Il resta croyant toute sa vie jusqu’à sa mort en 1547.
Les Portugais furent chassés, et voyant les relations tendues avec le Kongo, ils décidèrent de faire une rencontre amicale avec le peuple Ndongo, état vassal du Kongo. Mais plus tard, après quelques conflits avec le royaume Kongo, une guerre éclata entre ces deux royaumes, et le royaume Ndongo, fondé par Ngola Inene, vainquit une armée Kongo vers 1556.
Le roi Ndongo à l’époque déclara à ses conseillers : « Nous avons signé beaucoup d’accords avec les Portugais, mais ils ne sont pas dignes de confiance. Souvenons-nous de la tradition orale de l’histoire de Nzinga Mvemba, Alphonse 1er. »
Une succession rapide des rois commença à avoir lieu au royaume Kongo, juste après la mort d’Alphonse 1er. C’est Pedro 1er (Nkanga a Mvemba) qui devint roi en 1543 jusqu’à sa déposition en 1545.
Le royaume Kongo qu’on avait connu, où la joie, les danses, le bonheur régnaient, n’était plus qu’un royaume qui ne tenait plus qu’à un bout du fil. Le conflit externe et interne existait et conduisait peu à peu à la destruction de ce grand royaume. Le Royaume Kongo qu’on avait connu, où la joie, les danses, le bonheur régnaient, n’était plus qu’un royaume qui ne tenait plus qu’à un bout du fil. Le conflit externe et interne existait et conduisait peu à peu à la destruction de ce grand royaume.
Ce récit couvre les événements survenus entre 1539 et 1665.
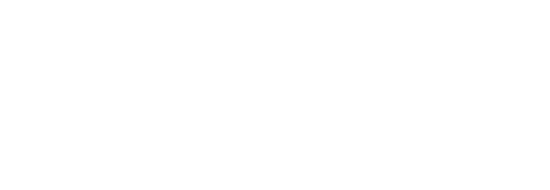
Annotations
Versions