3.1 – Banquiers d’affaires
Dans Front-Street, à cent mètres du Continental, se dresse un bâtiment d’un étage, remarquable par la solidité de sa structure, qui voisine avec de nombreuses sociétés de transport maritime, de courtiers, d’établissements bancaires, de maisons d’habitation à larges balcons et à vérandas immenses.
Ses murs de pierre contrastent avec les constructions proches bâties en brique ou en bois. La porte, taillée dans des poutres de chêne garnies de plaques de fer, ressemble à celle d’une prison. Quant aux fenêtres du rez-de-chaussée, les carreaux dépolis sont protégés par de solides barreaux entrecroisés formant un maillage assez serré pour qu’il fût impossible d’y glisser un bras.
Sécurité et économie de temps sont les principes qui ont prévalus dans la construction de l’édifice : outre que des volets n’ont jamais arrêté des voleurs expérimentés, on épargnait ainsi aux domestiques de les enlever le matin et de les remettre le soir. Or, en Amérique plus qu’en aucun autre pays, la devise « Time is money » est de notoriété publique et l’on ne ménage pas sa peine pour gagner dix minutes de temps de travail d’un salarié.
Au plan tant esthétique qu’architectural, la maison, si formidablement défendue, a une certaine ressemblance avec un fortin. Mais, ses propriétaires ne l’ont probablement pas fait construire dans le but unique d’embellir la rue principale de Colón. Il semble évident qu’ils ne l’occupent pas, non plus, pour jouir du panorama splendide de la rade qui s’offre à eux mais bien parce que l’emplacement est stratégique pour ces brasseurs d’affaires.
Au-dessus de la porte, en lettres rouges sur un panneau gris, une inscription : « Schmidt, Johnson and C°. » Et, au-dessous du nom de l’entreprise, le mot « banquiers » traduit en 5 langues.
Ce terme de « banquier » a, dans le Nouveau Monde, une signification beaucoup plus large que celle que nous lui donnons généralement en Europe. Il reçoit des dépôts d’argent, exécute des ventes et des achats sur les différentes bourses d’Europe et d’Amérique, fait l’escompte du bon papier et l’usure sur le mauvais, avance sur gages, prête sur les troupeaux et les marchandises, bref se livre à toutes les opérations qui peuvent avoir pour but de faire tomber dans sa caisse onces et piastres, rapidement et sûrement.
M. Schmidt, un Allemand que la misère avait chassé d’Europe en 1871, exerçait à Colón, quelques années auparavant, le métier de colporteur. Il se promenait par la ville, escorté d’une mule sur les flancs de laquelle ballottaient d’énormes paniers en osier dans lesquels il entassait pêle-mêle tout ce qu’on voulait bien lui vendre : vieux habits, ustensiles de ménage ayant cessé de plaire, machines usagées ou détraquées, récipients quelconques cassés. Rentrés chez lui, l’Allemand consacrait le temps qui lui restait à trier minutieusement le contenu de ses paniers, et ensuite avec une ingéniosité incroyable, il raccommodait, retapait, rajustait, fourbissait, astiquait, transformait vêtements, ustensiles, armes, instruments et accessoires.
Puis, lorsqu’il avait redonné à tout cela un aspect, sinon de choses neuves, du moins d’objets dont on pouvait encore se servir, il revendait en se contentant d’un petit bénéfice pour écouler plus rapidement ses marchandises.
Il s’était construit lui-même à côté des wharfs, une cabane avec des planches de caisses à savon, clouées au moyen de quelques pointes et, l’exiguïté de son habitation lui interdisait absolument d’accumuler des stocks de produits. Alors que la fièvre de l’or atteignait son paroxysme sur tout le continent américain et au-delà, M. Schmidt avait déjà amassé un bon pécule. Ce serait bien mal connaître le pragmatisme allemand que de supposer qu’il eût songé un seul instant à risquer ses économies dans l’exploitation des terrains aurifères de la Californie.
Seulement, en homme pratique, il résolut de tirer parti de la situation géographique de Colón où devaient forcément prendre pied, dès qu’ils arrivaient de l’ancien ou du nouveau monde, tous ceux qui couraient au pays de l’or. Il fit un voyage à New York et revint au bout d’un mois avec une cargaison complète de vêtements solides, de bottes inusables, de toiles de tente, d’instruments et d’outils variés.
Il loua un terrain à proximité immédiate des quais où débarquaient les migrants et installa son nouvel établissement. Et pendant tout le temps que dura cette folie de l’or, il vendit à un rythme effréné, resta assez sage pour ne point profiter de son succès et augmenter ses prix, se contentant de gagner quinze pour cent sur chaque vente.
Ainsi, sans avoir risqué grand-chose, il se trouva bientôt à la tête d’une jolie somme. C’est alors qu’il fit la connaissance de Charles Johnson, citoyen des Etats-Unis qui arrivait de Californie avec les restes fort respectables encore d’une fortune considérable découverte dans les sables aurifères. Les deux hommes, après une collaboration fructueuse sur une grosse opération d’achats groupés de matériels de travaux pour les entreprises sous-traitantes de la Compagnie du Canal, finirent par s’associer.
Cette association prospéra rapidement. Outre ses piastres et ses dollars, chacun des associés apportait ses compétences spécifiques, des caractères également pragmatiques dont les qualités et les défauts se contrebalançaient mutuellement. Les charges d’entretien indispensables au fonctionnement de la Panama Rail Road, sans cesse menacée de destruction par la progression invariable de la forêt tropicale, les firent s’installer banquiers pour proposer, aux entrepreneurs sous-traitants, de modestes avances de fonds.
Dans ces opérations-là, encore, les deux acolytes furent chanceux et leur situation prospéra très vite. Si rapidement même, que leur établissement bancaire se dédoublait, et que Charles Johnson alla ouvrir une succursale à Panama, place de la Liberté, tandis que Conrad Schmidt demeurait à Colón.
Puis vint la création de la « Compagnie Universelle du Canal Interocéanique de Panama, le 20 octobre 1880.
En novembre 1880, et sans que l’on pût avoir là-dessus aucun détail, les deux associés initièrent la construction dans Front-Street, de cette bâtisse fortifiée, qui faisait loucher les pauvres et pester les voleurs. A la stupéfaction générale, la raison sociale se transforma en Schmidt, Johnson et C°.
*
Huit jours après la rencontre au Continental, entre Pierre Vimereau et Francesco Martorana, penché sur son bureau, dans son cabinet situé au premier étage, M. Schmidt dépouillait son courrier. De temps à autre, il levait la tête pour jeter un coup d’œil dans un petit miroir placé devant lui, suivant un plan incliné. Par les effets combinés d’une association de glaces, il pouvait surveiller le personnel qui travaillait dans la pièce du rez-de-chaussée. Là, depuis longtemps déjà, les employés, des comptables pour la plupart, avaient le nez dans leurs registres qu’ils étudiaient sans relâche. Schmidt et Johnson payaient bien, mais il leur en fallait pour leur argent.
Après avoir constaté que chacun était à son poste et que toutes les plumes couraient fébrilement sur le papier, Conrad Schmidt poursuivit son travail. C’était un homme froid, au visage impassible, qui ne s’impatientait jamais. Impossible de deviner à sa mine si les lettres qu’il examinait le satisfaisait ou pas. Il les prenait à sa gauche, les unes après les autres, les annotait rapidement au crayon bleu après y avoir jeté un coup d’œil, puis, avec la régularité d’un métronome, en faisait deux tas bien distincts à sa droite.
De temps à autre, sans interrompre sa lecture, il appuyait sur l’un des boutons électriques placés à portée de main. Un agent entrait et, sans même le regarder, en quelques mots brefs, il lui donnait un ordre, une explication, puis reprenait son travail.
Soudain, sans qu’il eût appelé, la porte s’ouvrit et un garçon de bureau s’avança.
Au bruit des pas frôlant le parquet de pitchpin, M. Schmidt releva la tête.
— Qu’y a-t-il ? demanda-t-il en fronçant le sourcil.
— M. Peterson est là.
Les yeux du banquier cherchèrent un calendrier accroché au mur.
— C’est vrai, murmura-t-il, nous sommes samedi, aujourd’hui.
Et, un éclair de satisfaction illumina fugacement son regard froid.
— Fais-le venir, dit-il en jetant une grande feuille de papier buvard sur le courrier épars devant lui.
Un homme de taille imposante pénétra dans la pièce presque aussitôt, une serviette de cuir bourrée de documents sous le bras. Une casquette de feutre vert foncé coiffait un visage large et coloré, encadré de favoris roux taillés en brosse qui rejoignaient une moustache courte et hérissée. Le nez était légèrement épaté comme celui d’un boxeur. Les yeux noirs et vifs profondément enfoncés dans leur orbite firent rapidement le tour de la pièce avant de se poser sur Schmidt.
— Bonjour, Bradley, dit ce dernier en adressant un sourire aussi aimable qu’inattendu au nouvel arrivant.
— Bonjour, Monsieur Schmidt, répondit celui-ci, déposant sur le bureau la lourde serviette de cuir qui rendit un son mat et métallique.
— Ouf ! souffla-t-il ensuite en se laissant choir, sans façon, sur le premier siège venu. Si cela continue, Monsieur Schmidt, il me faudra le concours d’un porteur pour mes visites du samedi.
Et il éclata d’un rire tonitruant.
Conrad Schmidt se frottait machinalement les mains.
— Alors, la recette est bonne ? murmura-t-il.
— Jugez-en vous-même.
Brad Peterson se leva, ouvrit la serviette et en tira alternativement une grosse liasse de documents et trois sacs de toile qu’il déposa devant le banquier, énonçant simplement :
— Onces, piastres, demi-piastres…
Et successivement aussi, Schmidt soulevait les sacs, les soupesait, puis lisait à mi-voix sur une étiquette collée sur chacun d’eux.
— Quatre-vingt-cinq onces… deux cent cinquante piastres… trois mille demi-piastres.
Songeur, il ajouta :
— Les petites bourses ont craché cette semaine.
— Plus ça va, répondit Bradley, et plus les ouvriers semblent prendre goût au jeu… mais les commerçants donnent aussi.
Et tirant un portefeuille de sa redingote bien coupée, il le tendit à Schmidt en disant :
— Voici les bank-notes.
— Pour combien y en a-t-il ?
— Pour cinq mille piastres.
Le banquier saisit, dans un casier fermé à clé, un petit registre sur la couverture duquel étaient écrits ces mots : Continental Bar.
Rapidement, il feuilleta le carnet, s’arrêta sur une page couverte de chiffres et l’examina quelques instants. Puis il inscrivit les montants des sommes contenues dans les trois sacs de toile, fit l’addition et le refermant avec un petit claquement de langue satisfait :
— Nous sommes en progrès sur la dernière décade de deux cent cinquante piastres.
Puis, il enchaîna :
— A propos, combien de suicides, cette semaine ?
— Cinq seulement.
— C’est un de plus que la semaine précédente, grommela Conrad Schmidt d’un ton mécontent… quelles nationalités ?
— Un Français, deux Anglais et deux Italiens.
— Pas d’Allemand ?
— Les Allemands ne viennent pas au Continental.
Le banquier eut un sourire fugace.
— Ce sont des travailleurs, eux. Des gens sérieux sur qui on peut compter, ajouta-t-il dans un murmure.
— J’ai apporté différentes petites notes que voici, dit le directeur du Continental. Vous les examinerez quand vous en aurez le loisir.
Il tendit à Schmidt des fiches que celui-ci plaça sur un coin de son bureau.
— Etes-vous satisfait, Monsieur ?
— Très satisfait, mon cher Brad… si mon associé y consent, nous augmenterons vos appointements de cinquante piastres.
— Par mois ?
— Pensiez-vous que ce soit par semaine ? demanda un peu sèchement le banquier.
A cet instant, l’on frappa à la porte.
— Entrez, cria-t-il.
C’était à nouveau le garçon de bureau
— Monsieur, il y a là un monsieur qui insiste pour vous parler.
— Son nom ?
— Il a refusé de me le dire… mais il vient pour affaire de banque…
Le visage de Conrad Schmidt devint soucieux.
Il se leva, appuya sur la cornière de la bibliothèque garnie d’un nombre impressionnant de registres et autres dossiers soigneusement alignés. Un pan de rayonnage pivota silencieusement et sans heurt, dévoilant une porte dérobée dans le lambris du mur et il dit :
— Sortez par-là, il est inutile que l’on vous repère ici.
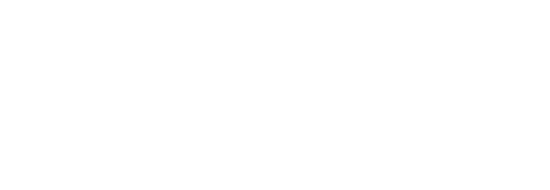
Annotations