Chapitre 20 : une de ses élèves
Pour notre fusée, l’année 1955 fut singulièrement calme. En effet, de nombreuses tempêtes de sable nous obligèrent à annuler tous les lancements programmés. Nous eûmes donc le loisir de nous intéresser à la politique locale, particulièrement mouvementée.
Cette année marqua un tournant, du point de vue géopolitique, en Afrique du Nord. Pas très loin de nous, dès janvier, la France s’engagea plus avant dans la répression des velléités indépendantistes algériennes. En moins d’une semaine, près de 5 000 soldats français se déployèrent dans les Aurès, à notre grand désarroi, pour une opération appelée… Véronique. Dans le même temps, le nouveau Gouverneur général d’Algérie essayait d’avoir une vue exhaustive de la situation afin de proposer des solutions au gouvernement parisien. Devant la poursuite des troubles, le Président du Conseil déclara l’état d’urgence pour six mois dans une partie du département[1].
En avril, alors que nous prenions notre café, nous apprîmes à la radio la tenue de conférence de Bandung, regroupant des représentants de 29 pays, à l’initiative du « groupe de Colombo » (Inde, Ceylan, Birmanie, Indonésie et Pakistan) avec pour but de créer un troisième axe face à l’Occident ainsi qu’à l’URSS et ses alliés. Ainsi naquit l’ensemble dit des « non-alignés » avec l’Inde comme leader. Une délégation du FLN[2] était présente à cette conférence qui condamna clairement le colonialisme sous toutes ses formes. De cette façon, débuta la reconnaissance des indépendantistes algériens. Curieusement, cette information passa jusque dans les tribus nomades les plus reculées.
En mai, à notre grande surprise, les conventions franco-tunisiennes accordant l’autonomie interne à la Tunisie furent signées. Habib Bourguiba[3], après trois ans d’exil, revint dans son pays.
Quelques jours plus tard, le Gouverneur général d’Algérie présenta son rapport au gouvernement français. Il préconisait des changements axés sur le développement économique de l’Algérie et une plus grande intégration des « indigènes » dans les bénéfices de celui-ci. Il était temps de passer à autre chose que du tout répressif. Seule l’association plus étroite des Algériens aux profits que la France tirait de leurs terres pourrait – au moins temporairement – espérer apaiser les ardeurs indépendantistes. Le débat fut vif au sein de notre équipe, entre ceux qui pensaient que mieux partager les richesses de l’Algérie permettrait un retour au calme, celles ou ceux qui étaient partisans d’une autonomie comme en Tunisie voisine et ceux – au final peu nombreux parmi nous – qui ne voyaient que par la manière forte.
Dans le même temps, survint une vague d’attentats dans le Constantinois. Par bonheur, personne dans notre équipe n’avait d’amis ou de famille vers Constantine. J’imagine que ce fait, ajouté à celui de nous trouver au fin fond du désert, dans une base militaire, nous avait donné l’impression que cela se déroulait loin de nous et que nous n’étions qu’indirectement concernés. Cependant, en réponse à ces événements, l’effectif des forces de sécurité dépassa rapidement les 100 000 hommes avec le début du rappel des réservistes. Pour le moment, ces mouvements de troupes ne concernaient pas les soldats responsables de la protection de notre base.
Le 6 novembre, les accords de La Celle-Saint-Cloud allaient mettre fin au protectorat français au Maroc avec Sidi Mohammed ben Youssef comme sultan. Celui-ci effectuerait un retour triomphal sous les vivats des Marocains à Rabat le 10 novembre en se faisant désormais appeler Mohammed V du Maroc.
En résumé, la première moitié de l’année 1955 vit les deux voisins de l’Algérie se diriger vers l’autonomie ou l’indépendance, alors que dans le même temps la France renforçait son action répressive, augmentant nettement sa présence militaire. La volonté d’indépendance qui commençait à recueillir un certain soutien international, serait-elle étouffée par les mesures de développement économique promises ? Comment cela allait-il tourner pour nous, à Hammaguir ? Voilà en quoi consistaient les principaux sujets de nos discussions, entre deux lancements annulés pour cause de confinement.
L’année 1955 fut aussi le moment où la mainmise de l’armée sur le projet Gerboise bleue (toujours appelé de façon secrète « M1 ») devint quasiment totale, ce qui scandalisait Simone.
— Tu te rends compte, Robert, sous prétexte que c’est la bombe atomique, les militaires ne veulent plus entendre parler de civils pour sa mise au point.
— Ben, ça me semble normal, non ?
— Mais non ! Ils n’y connaissent rien ! Déjà que c’est extrêmement compliqué d'évoquer la radioprotection au CEA, alors imagine avec des soldats… Et puis l’atome, c’est trop sérieux et dangereux pour n’être confié qu’à l’armée !
— Sans doute…
Elle était vraiment en pétard. Simone était chatouilleuse sur le maintien de ses prérogatives et détestait qu'on décide à sa place, ce qu’elle devait étudier.
— En plus, insista-t-elle, c’est dans les statuts du CEA, depuis l’ordonnance de 1945 signée par le Général de Gaulle. Écoute ça, Robert : « Le CEA est maître d’œuvre en matière d’armement atomique » ! C’est écrit noir sur blanc !
— Je comprends…
— On est plusieurs à être vraiment furax au CEA, mais on n’a pas eu le dernier mot, fit-elle dépitée.
Cela ne m’étonnait finalement pas vraiment. Quand l’armée voulait quelque chose, elle l’obtenait à chaque fois.
— Ah bon ?
— Et bien, les ministères de tutelle ont créé un nouveau « machin » au sein du CEA, le Département des Techniques Nouvelles. On sent bien que ça va devenir un « truc » uniquement dédié aux applications militaires. D’ailleurs, il y a plein de soldats, des soi-disant scientifiques qui ont débarqué…
— Vous arrivez quand même à travailler ensemble ?
— Il faut bien. Bon, j’avoue que dans le lot, il y en a quelques-uns qui sont excellents dans leur domaine, convint-elle.
— Ah, tu vois, tous les militaires ne sont pas des abrutis, répondis-je en souriant.
J’étais certain qu’elle avait « entendu » mon sourire.
— Non, en effet, admit-elle
— Je te rappelle que ton frère en est un et que moi, en plus du fait d’être le responsable du projet Véronique, je l’ai été aussi.
— Oui, c’est vrai.
— J’aime quand tu me dis que j’ai raison, Simone, cela n’arrive pas si souvent.
— Je ne l’ai pas exactement dit.
— Simone !
— Oui, tu as raison, Robert.
À mon tour, je pus entendre son sourire en réponse à mes mots.
Elle me raconta également que l’arrivée en force de ces militaires et le sujet sensible du domaine nucléaire avaient entraîné une véritable obsession du secret au sein de cette partie du CEA. Ils mangeaient à part, évitant les contacts avec les personnels civils de Saclay ou Fontenay-aux-Roses. Le centre du CEA de Bruyères-le-Châtel, où serait mis au point « Gerboise bleue », n’était évoqué qu’en parlant de « B3 ».
Les recrutements au sein de cette équipe étaient laborieux et très longs, tant les enquêtes étaient poussées préalablement à ces embauches. La moindre sympathie avec un parti ou un syndicat de gauche était considérée comme rédhibitoire. Il ne fallait pas oublier le contexte avec la signature de l’appel de Stockholm pour un usage uniquement civil de l’atome, signé par le premier directeur du CEA, Frédéric Joliot-Curie ainsi que la forte implantation du parti communiste dans le personnel de cet organisme. Il n’était pas question que les communistes s’infiltrent dans ce projet ! Simone avait de la chance de faire partie du CEA depuis longtemps et d’être une des références européennes dans le domaine de la radioprotection, sinon, qui sait ce qu’il serait advenu d’elle ? Il fallut par exemple six mois à Simone pour recruter un technicien ! C'était incompréhensible. Ce culte du secret devenait une entrave à l’efficacité de son travail.
La mise au point de cette bombe, en l’absence de toute communication ou publication de la part des États la possédant déjà (USA, URSS et Royaume-Uni) ne facilitait pas la tâche des scientifiques français, fussent-ils militaires, me confia-t-elle. En effet, il fallait créer un ensemble stable de matériaux nucléaires qui, une fois concentrés sur eux-mêmes, atteindraient une masse critique suffisante pour exploser. Il s’agissait donc de concevoir une sorte de boule creuse dont les parois, constituées de plutonium, seraient projetées vers le centre de la sphère par des explosifs disposés en surface. C’est ce qui est appelé Générateur d’Onde à Détonation Sphérique Centripète (GODSC). En l’absence de toute information extérieure fiable, la résolution de ce problème complexe consacra la première percée conceptuelle importante de ce projet.
Outre les discussions interminables sur la situation au Maghreb, nous trouvions tout de même le temps d’organiser des petites fêtes. Lors d’une de ces soirées bien arrosées, Paulo se confia un peu plus au sujet de la relation si particulière qui le liait à sa mère. Quel que soit l’endroit où il était, il lui téléphonait systématiquement tous les dimanches soir, ne serait-ce que quelques minutes, une sorte de rituel entre eux. Leur lien était singulier : même s’il était dû à un événement très ancien, la présence de son fils lui rappelait en permanence ce viol qui l’avait traumatisée à vie. Néanmoins, elle l’aimait de tout son cœur, son Paulo.
À cette occasion, sans doute un peu – très ? – alcoolisé, je lui évoquai l’homosexualité du frère de Simone. J’imaginais pourtant, suite aux échanges avec elle sur ce sujet, l’avoir admise depuis longtemps. Il faut croire que non, pas complètement…
— J’vais t’faire une confidence, Paulo. Mais tu le répètes à personne, hein ?
— Juré, Robert, tu m’connais, chuis une tombe !
— Je sais, Paulo, t’es mon pote en plus !
— Oui, on est potes tous les deux ! À la vie à la mort !
— À la vie à la mort, Paulo, mais le plus tard possible !
— Oui, on est d’accord, Robert.
— Arrête de me couper la parole. J’ai un tric à t’dire, tu vas pas en revenir…
— Dis toujours.
— Tu vois, Jean-Paul, celui qui était là avant ?
— Le frère de Simone ?
— Oui, celui-là !
— Eh ben ?
— Ben… Tu me jures que tu le répètes pas, hein ? Sinon, Simone, elle me tuerait, je crois.
— Tu veux que je crache par terre, me demanda-t-il ?
— Non, pas la peine, j’te crois, t’es mon pote.
— Oui, je le suis, à la vie…
— Je sais, Paulo.
— Alors ?
— Eh ben, Jean-Paul, il aime les hommes…
— Et ?
— Ben, il est pas comme nous, non ?
— C’est pas le frère de ton amoureuse ?
— Ben si.
— Il n’était pas bon quand il était avec nous ?
— Si.
— Est-ce que ça a posé une seule fois un problème avec nous qu’il aime les hommes ?
— Non, jamais.
C’était dingue, à croire qu’il avait parlé avec Simone.
— Il n’a pas toujours été super, avec toi en particulier ?
— Si.
— Alors, il est où le souci ?
Paulo, le bon sens personnifié.
Il fallait que j’en aie le cœur net :
— Tu étais au courant ?
— À vrai dire, je m’en doutais un peu.
— Et tu t’en foutais ?
— Totalement ! Tu devrais d’ailleurs faire pareil !
— Tu dois avoir raison.
— Un peu que j’ai raison, Robert, allez, viens boire un autre coup !
— Quand même, ça doit pas être facile tous les jours pour lui…
Il était temps que je m’en aperçoive. Si Paulo trouvait ça naturel et normal, pourquoi est-ce que je m’en ferais ?
— Non, raison de plus pour ne pas s’occuper de sa vie privée, tout en restant son ami.
— Des fois, chuis un peu con, convins-je.
— Oui, des fois, approuva-t-il avec un grand éclat de rire, tout en me servant un autre verre. Mais t’es un bon chef ! Allez, à la santé de Jean-Paul !
— À Jean-Paul !
Je ne me rappelle absolument pas le reste de la soirée, juste que j’ai eu très mal aux cheveux toute la journée suivante.
Début 1956, pour notre plus grande inquiétude, les événements d’Algérie devinrent sans nul doute la « guerre d’Algérie », même si à l’époque on taisait ces mots. Cela démarra dès janvier par la démission de deux généraux, protestant contre la lenteur de l’envoi des renforts de troupes. Cela commençait à rouspéter fortement au sein de la « Grande Muette ». Le Président du conseil, venu à Alger pour tenter d’apaiser la situation, fut conspué par les Pieds-noirs[4] et reçut divers objets, dont, semble-t-il, des œufs pourris, des tomates ainsi que d’autres légumes pas forcément frais.
Devant la colère des Algérois[5], il finit par céder : au lieu d’un Gouverneur général – comme la Tunisie et le Maroc avant leur processus d’indépendance ou d’autonomie – il y aurait un Ministre-résident. Toujours sous la pression, un fidèle partisan de l’Algérie française et l’un des plus farouches opposants au FLN, un socialiste, ancien résistant de la première heure, fut propulsé à ce poste. Il était connu pour dire tout le mal qu’il pensait de ceux qui, en métropole ou dans les couloirs de l’ONU, faisaient preuve d’indulgence vis-à-vis de ces attentats et assassinats perpétrés par le FLN.
Si sa nomination fut saluée par certains militaires présents à Hammaguir, elle fut accueillie avec un peu plus de circonspection par beaucoup d’autres. Son arrivée n’était pas un signe d’apaisement, mais plutôt de durcissement de la répression anti-indépendantiste. Dans le même temps, les « harkas » furent créées, composées d’Algériens, partisans de l’Algérie française. Peu après, l’Assemblée nationale vota les pouvoirs spéciaux au gouvernement, pour faire face à la situation. Les autochtones travaillant pour nous étaient eux aussi partagés sur ces harkas. On les entendait s’écharper en arabe et presque en venir aux mains. Les soldats présents à nos côtés ont dû plusieurs fois en séparer. Quelques-uns des Algériens qui étaient avec nous depuis le début disparurent ainsi, peut-être dans les rangs de l’ALN ou comme auxiliaires de l’armée française, nous n’en avions aucune idée.
Presque simultanément, le 20 mars 1956, l’indépendance fut accordée à la Tunisie par la signature du protocole franco-tunisien. Celui-ci mit fin au traité du Bardo de 1881 qui instituait le protectorat français dans le pays. Une fois l’Assemblée constituante élue, Habib Bourguiba en fut nommé président par acclamations.
Quel contraste entre les deux voisins.
J’appris avec tristesse par Simone le décès de l’une des grandes figures de la chimie, de la radiochimie et de la physique. Le 17 mars 1956, Irène Joliot-Curie nous avait quittés pour rejoindre les étoiles. Simone, bouleversée, avait travaillé avec elle et son mari sur les débuts de la pile Zoé. Quelques jours plus tard, des funérailles nationales lui furent consacrées. Le pays tout entier lui rendit un hommage chaleureux et ému. Simone me raconta la cérémonie en détail et me dit que nombreux étaient celles et ceux qui pleuraient sur le passage de son cercueil.
Elle s’avérait une scientifique hors pair, doublée d’une femme engagée politiquement. D’abord contre le fascisme, dès 1934, elle essaya même d’amener, sans succès, Léon Blum à envoyer des troupes aux côtés des républicains espagnols contre le franquisme. Pacifiste acharnée, elle avait signé l’appel de Stockholm avec son mari, pour limiter les usages de l’atome au domaine civil, sans convaincre, il faut bien le reconnaître. Féministe, elle avait également lutté pour que les femmes soient admises à l’Académie des sciences, mais sans résultat immédiat. Toutefois, la première scientifique accueillie dans cette institution, en 1962, serait une de ses élèves.
[1] Organisation administrative de l'Algérie: Jusqu’en 1955, l’Algérie était divisée en trois départements : Alger, Oran et Constantine alors que la partie saharienne, appelée territoires du Sud, relevait de l’administration militaire. Il s’agit là du sud du département de Constantine (Le massif des Aurès est principalement situé dans le sud de ce département).
[2] Le Front de libération nationale, officiellement Parti du Front de libération nationale, est un parti politique algérien fondé en 1954 pour obtenir de la France l’indépendance de l’Algérie, alors divisée en départements. Le FLN et sa branche armée, l’Armée de libération nationale (ALN), commencent alors une lutte contre l’empire colonial français.
[3] Habib Bourguiba : Avocat formé en France dans les années 1920, il revient en Tunisie pour militer dans les milieux nationalistes. En 1934, à l’âge de 31 ans, il fonde le Néo-Destour, fer-de-lance du mouvement pour l’indépendance de la Tunisie. Plusieurs fois arrêté et exilé par les autorités du protectorat français, il choisit de négocier avec la Quatrième République, tout en faisant pression sur elle, pour atteindre son objectif. Une fois l’indépendance obtenue le 20 mars 1956, il contribue à mettre fin à la monarchie et à proclamer la République, dont il prend la tête en tant que premier président le 25 juillet 1957.
[4] D’après le Larousse, « pied-noir » (et « pieds-noirs ») est un nom et un adjectif qui signifie : « Français d'origine européenne installé en Afrique du Nord jusqu'à l'époque de l'indépendance » « Français vivant en Algérie (et considérant l'Algérie française comme sa patrie) » ; puis « Français originaire d'Algérie ».
[5] On dit « algérien » pour l’Algérie en général et « algérois » pour Alger, la capitale, spécifiquement.
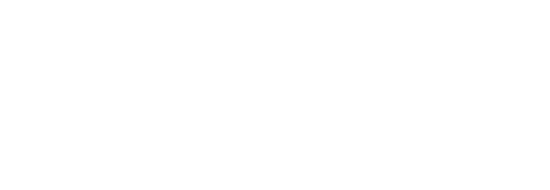
Annotations
Versions