Chapitre 33 : je n'en menais pas large
En attendant mon départ pour l’autre côté du globe, je continuai, durant mon temps libre, à rassembler mes souvenirs. J’avais promis à Simone de les coucher sur papier et, qui sait, peut-être un jour, de les transformer en livre. Pour le moment, les histoires me revenaient plutôt mélangées, j’essayais de les classer par ordre chronologique, au fur et à mesure que je les écrivais. Quand j’avais un doute sur une anecdote ou un enchaînement d’opérations, je n’hésitais pas à téléphoner à Paulo. Il avait une mémoire impressionnante, même si celle-ci n’était pas d’une objectivité totale. Il avait par exemple un peu oublié son rôle dans le fameux essai raté du filoguidage, ainsi que le conseiller ministériel ratatiné avec son chauffeur. Toutefois, entre ses souvenirs, les miens et ceux du reste de l’équipe, j’allais finalement arriver à reconstituer toute cette épopée magnifique de la France spatiale.
Début juin, je m’envolai enfin vers les USA, puis l’Australie. Les préparatifs se terminaient pour ce qui devait représenter le couronnement de ce projet Europa. Entretemps, deux nouveaux pays étaient devenus des « nations spatiales » : en février, le Japon avait placé le satellite Ôsumi en orbite, lancé par une fusée Lambda et quelques mois plus tard, la Chine avait placé en orbite Dong Fang Hong 1 à l’aide du lanceur Longue marche 1. Il y avait désormais cinq nations spatiales dans le monde : l’URSS, les USA, la France, le Japon et la Chine. L’Europe allait-elle bientôt se joindre à ce groupe ? C’était le but des essais d’Europa au départ de la base de Woomera en Australie.
Cette base aérienne, cette zone d’exclusion militaire plutôt était incroyablement étendue, située à 450 kilomètres au nord d’Adélaïde. Avec près de 127 000 kilomètres carrés, elle représentait le plus grand terrain militaire du monde, presque la superficie de l’Angleterre[1] et presque une fois et demie celle du Portugal. J’ai appris beaucoup plus tard que cette base était située sur une région désertique, mais sacrée des Aborigènes. À l’époque de sa création, en 1947, juste après la Seconde Guerre mondiale, l’avis des natifs ne comptait pas en Australie… En même temps, avait-on fait mieux à Hammaguir ? Je n’en étais pas certain, avec les Bédouins qu’on avait priés d’aller « nomadiser ailleurs », sans parler de la zone des essais nucléaires, que la France avait dû rendre quelque peu contaminée aux autorités algériennes, d’après ce que m’avait laissé entendre Simone.
Il s’agissait clairement du meilleur site de lancement du Commonwealth et pourtant, il se trouvait sans doute au beau milieu d’une ancienne mer intérieure et le sol présentait une teneur en sel extrêmement haute, quatorze fois plus élevée à celle de l’eau de mer. Ceci entraînait de gros problèmes de corrosion pour tous les matériaux à base d’alliage ferreux.
Profitant de ma première venue, mais sans me faire trop d’illusions, et en attendant le tir d’Europa, j’essayai de me renseigner sur leur connaissance du Triangle d’été et d’une éventuelle étoile qu’ils auraient détectée dans cette zone-là. Malheureusement, comme je l’avais escompté, cette constellation n’était pas visible en Australie et, bien entendu, personne n’avait jamais entendu parler d’un astre inconnu dans cette région du ciel. Pourtant, le vieux Bédouin vu par deux fois à Hammaguir me l’avait assuré, je savais déjà de quoi il s’agissait… Oui, mais quoi ? Qui sait si j’aurais un jour une explication qui tiendrait la route ?
J’assistai au lancement en tant qu’invité de marque, car futur pilote du tir suivant à Kourou. Au préalable, j’avais eu droit à un laïus qui m’avait vanté les mérites de ce projet et m’avait présenté, à moi ainsi qu’à tous les autres VIP présents, les leçons qui avaient été apprises des ratés précédents. L’échec n’était même pas envisagé cette fois-ci.
La fusée était magnifique sur son pas de tir. Avec ses plus de trente mètres de haut, à comparer à la vingtaine de mètres de Diamant-B, elle était impressionnante. Je voulais y croire. On voulait tous y croire sur place.
J’étais donc plutôt confiant lorsque je me rendis au poste de commandement pour assister au dernier lancement australien d’Europa. Après tout, peut-être m’étais-je trompé et peut-être ce projet, pourtant mal ficelé dès le début et sans véritable pilote, était-il réellement l’avenir spatial de l’Europe ?
À l’heure prévue, l’allumage du premier étage eut lieu. Dans un premier temps, Europa s’éleva lentement avant de s’élancer vers le ciel. La séparation du premier étage se fit parfaitement, tout comme la mise à feu du second. Coralie, l’étage français, avait fonctionné. LA fusée se sépara alors du deuxième étage, laissant le troisième terminer l’ascension. Tout semblait se passer à la perfection. Il s’éteignit à son tour et là, catastrophe : la coiffe ne s’ouvrit pas. Tous ces efforts pour rien… Encore un essai avorté. Il devait être écrit que ce programme ne serait qu’un échec. Europa -1 était un ratage complet.
Je rentrai, un peu triste, à Kourou. Même si, dès le début, je n’avais pas réellement cru en ce projet sans vrai pilote décisionnaire, j’étais frustré, comme lors de chaque tir loupé. J’aurais tellement préféré avoir tort et assister au succès de ce lancement australien. J’espérais qu’on ferait mieux avec Europa-2, modèle « amélioré », comportant un 4e étage, que nous allions faire décoller du CSG. Il était prévu deux tirs de qualification puis la mise en orbite de deux satellites de télécommunication du programme franco-allemand Symphonie. Un beau projet entre deux pays qui travaillaient de concert, après deux guerres fratricides. Une telle idée suffirait-elle à mener à la réussite ?
Je m’épanchai sur mes doutes à ce sujet, lors d’une conversation téléphonique avec Simone :
— Ç’a été une vraie catastrophe. Europa -1, c’est terminé, définitivement…
— Programme enterré alors ?
— Non, tu penses. On est déjà sur Europa-2
Encore un projet qui n’avait pas de sens ni de réel pilotage et voué à l’échec comme le numéro un…
— Ah, donc la coopération européenne dans le domaine spatiale, ce n’est pas fini ?
— Non, pas du tout, Simone. On prend les mêmes et l’on recommence. C’est la même fusée qu’avec Europa-1, mais avec un quatrième étage en plus et sans les Anglais qui ont quitté le navire l’année dernière.
— Vous continuez à utiliser le premier étage britannique malgré tout, le Blue Steak ?
— Blue Streak, oui, fis-je en réprimant un sourire, qui avait quand même dû s’entendre au téléphone.
Elle avait l’oreille, Simone, elle était terrible pour ça.
— Ne te moque pas, Robert.
— Non, ce n’est pas mon genre, tu me connais, mon amour, répondis-je, toujours en souriant.
— Oui, c’est cela… Tu veux que je boudouille ?
— Non, Simone. J’aime autant pas. Surtout quand tu n’es pas à côté de moi.
Il s’agissait d’un mot qu’elle avait inventé, ou que j’avais inventé moi-même, je ne me souviens plus. Cela consistait en une sorte de bouderie, mais pas grave, plus un jeu entre nous. Elle était assez friande de ça, Simone.
— Donc oui, Simone, il y a bien un premier étage britannique, ce fameux Blue Streak, issu d’un missile militaire. Ils ne font toutefois que nous le fournir, on se débrouille du reste.
— Du coup, tu es plus confiant pour le lancement l’année prochaine à Kourou ?
— J’aimerais bien y croire… En fait, je ne sais pas trop. Il y a deux tirs de qualification prévus, mais j’ai peur que si le premier des deux foire, il soit décidé de tout arrêter.
— Qui va trancher ?
— La direction du CRS, je pense.
— Est-ce que ça ne sera pas pour passer sur un autre projet plus sérieux et plus fiable ?
— Si, sans doute…
— Dans tous les cas, c’est positif, non ?
— Tu te souviens de cette histoire du vide à moitié vide ou à moitié plein ?
Oui, c’était encore bien frais dans ma mémoire. Il s’agissait d’une attitude générale face aux aléas de la vie. Il était toutefois temps de m’enquérir de ses nouvelles à elle.
— Et toi, dis-moi, Simone, bientôt le démarrage de la deuxième centrale de Saint-Laurent.
— La deuxième tranche, oui, dans un an environ.
— Donc fini dans un an ? Tu vas faire quoi ensuite ?
— Je ne sais pas, il y a aussi un réacteur quasiment identique qui doit être construit dans l’Ain. Des projets de réacteurs d’un autre type sont dans les cartons également. Je vais peut-être travailler à leur conception.
— Un autre type ?
— Tu te rappelles, je t’avais parlé de ça il y a quelque temps. En fait, deux autres types en France : soit le brevet américain des Réacteurs à Eau sous Pression, soit les surrégénérateurs, des réacteurs à neutrons rapides. Il y a déjà un prototype en fonctionnement au CEA, Rapsodie, je crois. Un autre est en construction juste à côté.
Elle m’avait effectivement expliqué les différents modèles de centrales nucléaires en effet, entre les soviétiques, les canadiens, les américains et les français, il y avait de quoi faire.
— Rapsodie ? Mais je crois bien que c’est là que travaille Paulo ! Tu pourrais le retrouver là-bas !
— Ah oui, je n’y avais même pas pensé. Ce serait chouette ça. Tu as de ses nouvelles ? Ça se passe bien pour lui et sa petite famille ?
— Oui, ils vont tous bien. Josiane s’est bien adaptée et a trouvé sans difficulté un boulot dans une usine à côté. Alain est au collège et cela semble se dérouler parfaitement bien pour lui. Quant à Paulo, tu sais comment il est, non ?
— Il a fait des siennes au CEA aussi ?
— Non, enfin oui, mais moins qu’avec moi. Il est à un poste de responsabilité maintenant, il ne peut plus se permettre de se comporter comme ça lui chante. Il m’a raconté qu’avec ses gars, ça se passe très bien, vraiment très bien. Il est heureux. Avec ses chefs, ce n’est pas toujours facile, mais il est compétent, alors ils devront s’y faire…
Sacré Paulo, il avait changé en prenant un poste de chef, mais il était quand même resté identique à lui-même.
— Et son aîné, que devient-il ? Il demeure avec eux ?
— Robert vient tout juste d’avoir dix-huit ans et n’a pas dévié de son projet. Il veut toujours retourner en Guyane pour vivre de la chasse. Sa mère est catastrophée. En attendant, ils ont une « carotte » pour le faire travailler au lycée. S’il désirait revenir ici lors des vacances scolaires, il devait réussir son baccalauréat. Il vient juste d’avoir les résultats : reçu avec mention bien, ce qui est pas mal du tout !
— Ah oui, bravo ! Comment Paulo envisage-t-il le potentiel départ de son fils comme chasseur ?
— Bah, il prend ça comme il peut. Il a conscience que lui aussi n’a pas été facile alors qu’il était jeune. Il sait également que je garderai un œil sur Robert junior, même si ça ne sera pas simple quand il sera dans la jungle amazonienne. Je ne pourrai pas faire grand-chose. Mon filleul doit arriver dans quelques jours. On verra ce qu’il en sera début septembre, s’il repart en métropole ou s’il reste ici. Il est bien possible que deux mois dans la brousse le dégoutent totalement. À moins qu’ils ne le confortent dans sa décision ? On verra bien.
— Tu vas le laisser vivre dans la jungle aussi longtemps ?
Ça n’aurait tenu qu’à moi, sûrement pas, mais là, les conditions étaient « optimales » pour lui.
— Ne t’en fais pas, dans la famille de l’un de mes chefs de chantier, il y a des chasseurs professionnels. Il partira avec eux. J’ai confiance. Ça se passera bien.
— J’espère pour toi.
— Oui, sinon, je crois que Paulo, malgré toute notre amitié, ne me le pardonnerait pas.
— Je ne laisserai jamais Paulo te faire du mal, mon chéri !
Ah, ma guerrière…
— Ne t’inquiète pas, Simone. Ces chasseurs savent ce qu’ils font. Ils en vivent et connaissent bien la Guyane et ses pièges. Ils sont prudents, c’est leur métier.
— Inch Allah, comme tu le disais à Hammaguir, Robert
— Oui, tout à fait, Inch Allah.
Robert, mon filleul, atterrit en Guyane quelques jours plus tard. Je l’attendais à la sortie de l’avion. Il avait sacrément changé, un vrai jeune homme maintenant. Il me raconta dans la voiture qu’il s’était mis à la lutte et à l’athlétisme. Son père lui avait dit qu’il fallait qu’il apprenne à canaliser son énergie.
Après une soirée passée ensemble, durant laquelle mon filleul me donna des nouvelles fraîches de sa famille, puis une bonne nuit de sommeil, je l’amenai chez mon chef de chantier. Là, il rencontra les fameux chasseurs qui devaient s’occuper de lui pendant deux mois. Il devait faire connaissance avec eux avant de partir le lendemain en avion.
Au début, il fut quelque peu déstabilisé quand il les entendit parler un genre de créole[2]. Même moi, sur place depuis un certain temps, je ne comprenais qu’un mot sur deux, et encore. Toute la famille de mon chef de chantier était originaire du Suriname, des Bonis.
Un jour, celui-ci m’avait raconté son histoire, celle des siens ainsi que la fabuleuse saga de ces « Marrons », issus de métissages entre colons et esclaves et en révolte contre les maîtres blancs. Quand il commençait à conter, Gilbert était passionné et passionnant. Il m’avait fait partager la vie de ces bandes harcelant les esclavagistes dans le pays voisin de la Guyane française. Il m’avait fait vivre la fuite du clan commandée par Bokilifu Boni, le grand chef de la guérilla des Nègres Marrons du Suriname.
J’avais été plongé dans la fabuleuse bataille entre les Bonis et les milices de colons. Un contingent de fusiliers marins, avec à leur tête le colonel Louis Henri Fourgeoud, en provenance de Genève était venu épauler ces derniers. J’avais vécu la chasse aux Nègres Marrons dans les marécages, dans la forêt. J’avais été retranché parmi eux à Fort Bookoo, avec ses murs de quatre mètres, au milieu des marais, ce fort avait une route secrète pour y accéder, sous l’eau. J’avais essuyé la défaite infligée par Fourgeoud, mais vu aussi 90 % de ses soldats, pourtant aguerris, mourir dans la jungle. J’avais ensuite partagé l’exil des Bonis, réduits à quelques milliers, venus se réfugier sur la rive française du fleuve Maroni. J’avais également enduré les guerres fratricides entre les différentes communautés bushinenguées[3], issues des révoltes de ces Nègres Marrons, se terminant avec le massacre des Bonis par les Djukas.
Il ne resta finalement qu’une centaine de Boni. Pendant près de 70 ans, ils vécurent repliés sur eux-mêmes et coupés du monde. Il fallut attendre 1892 pour que la France leur offre un refuge officiel sur les rives du Maroni. Alors que les Bushinengués étaient soit de langue portugaise, soit anglaise, les Bonis représentaient finalement la seule communauté bushinenguée parlant français. La famille d’Albert fondait ses origines à Maripasoula[4], dans la jungle, entre le Brésil et le Suriname. Lui et toute sa famille connaissaient cette zone de la forêt amazonienne comme leur poche. J’étais rassuré de savoir mon filleul entre leurs mains.
Un des neveux de Gilbert, Jérémy, avait tout juste dix-huit ans, lui aussi. Naturellement, les deux jeunes hommes sympathisèrent. Ce neveu partait lui aussi faire sa première vraie chasse. À la différence de Robert, lui était familier de la jungle et ses dangers. Il épaulerait mon filleul, au moins durant les premiers jours.
— Ne t’inquiète pas pour son équipement, on s’occupe de tout. Robert junior sera comme un membre de ma famille. Mon frère me l’a garanti, me rassura Gilbert.
Après avoir bu deux-trois verres de rhum avec mon chef de chantier génie civil et ses frères, je laissai mon filleul, qu’il fasse connaissance avec ses futurs camarades de chasse. Je suis rentré à Kourou. Je passerai lui dire au-revoir le lendemain à l’aéroport.
Après ce que j’avais fait pour son fils en 68, je savais que Gilbert se sentait redevable et qu’il ferait le nécessaire pour que tout se passe bien.
À peine arrivé dans mon bureau, j’appelai Paulo et sa femme pour essayer de les rassurer. Leur fils devenait un homme, et sa première expérience de chasse dans la jungle se déroulerait avec les meilleurs. Je n’avais aucun doute sur le sujet. J’avais dit cela à Josiane au téléphone pour la tranquilliser, car pour elle, il était encore son « petit Robert ».
Après ce coup de fil, je partis faire une visite sur le chantier de l’Espace de Lancement Europa qui devait impérativement être terminé, au plus tard, début 1971. Il ne fallait pas chômer. Satisfait de l’avancement des travaux, je retournai à mon bureau et, après le reste de la journée consacrée à des tâches administratives sans grand intérêt, mais indispensables à la marche du centre de lancement, je me décidai à appeler Simone. Je m’étais rendu compte, chez Gilbert, que je ne lui avais jamais raconté la fabuleuse histoire, faite de sang, de larmes, de gloire et de déchéance, de la famille de mon chef de chantier. Évoquer avec elle l’initiation à la chasse de Robert serait une transition facile pour lui relater cette épopée. Bien qu’elle soit férue d’histoire et en particulier des hommes et des femmes dans l’Histoire avec un grand « H », j’étais certain qu’elle ne connaissait pas celle-ci. Elle fut effectivement passionnée et m’écouta sans mot dire.
— Eh ben, quelle saga extraordinaire tu m’as narrée là ! Il faut que tu ajoutes ça dans tes écrits, tu sais ?
— Tu crois ? C’est quand même loin de la conquête spatiale.
— Absolument pas ! C’est l’histoire de certains des hommes qui ont bâti Kourou. Il y a bien un lien. Ça explique d’où ils viennent.
— Tu as sans doute raison. Je vais faire quelques recherches sur le sujet à la bibliothèque de Cayenne et je pourrais ainsi mettre plus de détails.
— Au fait, il part quand dans la jungle, Robert « junior » ?
— Demain vers 8 heures. Ils décollent de Cayenne pour Maripasoula.
— Ils y vont en avion ? Eh ben…
— Normal, il n’y a pas de routes pour y aller. Ils vont survoler la forêt amazonienne tout le long du trajet.
— Faudrait pas qu’ils aient un problème sur leur parcours…
— T’en fais pas, c’est un vieux Boeing 247 qui fait la liaison Cayenne-Maripasoula. Ce type d’avion bimoteur peut même voler avec un seul moteur sur une longue distance.
Des souvenirs de mes cours de Supaéro m’étaient aussi revenus. C’était l’un des avions les plus sûrs, ancien, néanmoins très simple et fiable. Une raison de plus de ne pas être inquiet pour mon filleul. Toutefois, je savais aussi que la région pullulait d’orpailleurs. Même si l’or se raréfiait de plus en plus, ceux qui s’acharnaient à sa recherche pouvaient être agressifs et violents. Toutefois, il serait sur le « territoire Boni », donc celui de la famille d’Albert.
Malgré tout, je sentais toute la responsabilité qui reposait sur mes épaules. Il s’agissait du fils aîné de Paulo, mon ami depuis la guerre, celui qui m’avait suivi presque partout, ma « patte de lapin géante ». Je me rappelle qu’à ce moment-là, avant le départ de Robert junior pour la partie de chasse dans la forêt amazonienne, je n’en menai quand même pas large.
[1] La superficie de l’Angleterre (Grande-Bretagne moins Irlande, Ecosse et Pays de Galles) est environ de 130 000 km2. La surface du Portugal est 90 000 km2
[2] Le créole guyanais ou le guyanais est un créole à base lexicale française parlé en Guyane, au Suriname et au Brésil, dans une partie de l’État fédéré voisin de l’Amapá. Il a été également partiellement influencé par l’anglais, le portugais, l’espagnol et le néerlandais à la suite d’occupations successives. En cela il peut être très différent, pour certains mots, du créole martiniquais ou guadeloupéen.
[3] En Guyane, il existe une partie de la communauté des Noirs marrons originaire de la Guyane hollandaise (actuel Suriname) appelée Bushinengué. Il s’agit des descendants d’esclaves africains rebelles, ayant acquis leur liberté par la force en combattant au XVIIIe siècle leurs anciens maîtres. Les Boni, sont une des communautés bushinengués.
[4] Maripasoula est une commune française, située dans le département de la Guyane, au cœur du parc amazonien de Guyane. Avec plus de 18 000 km2 de superficie, c’est la plus grande commune française. Son étendue est une fois et demie celle de la région Île de de France. Cette commune est peuplée majoritairement par des personnes issues de l’ethnie Boni. C’est également la commune la moins densément peuplée de France étant donné que 99,9 % de son territoire est constitué par la forêt vierge amazonienne.
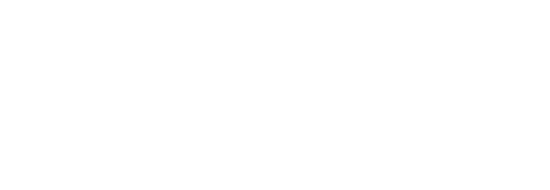
Annotations
Versions