Présentation par le traducteur
Le Nouveau Royaume de Grenade ou royaume de Nouvelle-Grenade, en espagnol Nuevo Reino de Granada, est le nom que la couronne d'Espagne donna à un territoire du nord de l'Amérique du Sud au XVIe siècle lors de sa colonisation des Amériques. Il couvrait une grande partie du territoire actuel de la République de Colombie, l'Équateur et une partie du Venezuela. Son territoire relève de l'Audience Royale (Real Audiencia) de Santa Fe de Bogotá de 1550 à 1718.
Et que trouve-t-on dans ces chroniques ? On y trouve l'histoire de Juana García, une esclave noire affranchie, avorteuse clandestine de femmes adultères, qui « était quelque peu sorcière » (ch. IX), l'histoire d'Inès de Hinojosa, une riche créole, belle, lubrique et manipulatrice, qui fit assassiner ses deux maris par ses amants (ch. X), l'histoire d'un commerçant pris par la Justice pour une affaire de fausse monnaie (ch. XI), l'histoire de l'assassinat d'un Espagnol, Juan de los Ríos, tué de quatre estocades, et à qui on arracha ensuite le coeur, on coupa le nez, les oreilles et les parties génitales avant de placer le tout dans un mouchoir (ch. XII). Et on y trouve aussi l'histoire de conquistadors assoiffés d'or, lancés à corps perdu à la recherche du mythique Eldorado au coeur d'immensités hostiles, parmi lesquels beaucoup périrent atrocement, mais dont une poignée de survivants parvinrent tout de même à empocher un butin considérable en or, argent et pierres précieuses extorqués aux indigènes, bien que l'Eldorado ne fut jamais découvert. Ou encore l'histoire de l'impitoyable campagne d'éradication des Pijaos, Indiens réputés cannibales, menée à partir de 1605 sous le commandement du président de l'Audience Royale de Santa Fe de Bogotá don Juan de Borja, après qu'ils eurent opposé aux Espagnols une résistance féroce de près d'un demi-siècle (ch. XIX). Et c'est aussi l'histoire, plus globale, de l'immense malheur que représenta la conquête européenne pour les différents peuples indigènes de cette partie du Nouveau Monde, à l'image des « neuf mille Indiens recensés » du canton de la ville de Victoria, réduits en esclavage et affectés à l'exploitation des mines d'or sur les terres qui étaient auparavant les leurs, et « qui se tuèrent tous pour ne pas devoir travailler, se pendant ou avalant des herbes vénéneuses, ce qui eut pour conséquence le dépeuplement et abandon de ladite ville » (catalogue A). Ce ne sont là que quelques exemples des cas que l'on trouve en ouvrant ce livre, connu en Colombie sous le nom d'El carnero (« La peau de mouton »).
Ces références à toutes ces histoires servent-elles à comprendre que les Chroniques du Nouveau Royaume de Grenade sont une des oeuvres les plus divertissantes qui aient été écrites au XVIIe siècle, non seulement en Amérique, mais aussi dans l'ensemble du monde hispanique ? Ces histoires, ainsi que d'autres moins scandaleuses, nous sont en effet racontées dans une narration clairement affiliée à la plus divertissante souche picaresque. Elles sont un exemple typique de la floraison sur le sol américain d'un genre littéraire, le récit intercalé qui, grâce au Décaméron ou à Don Quichotte, brillait déjà en Europe. En outre, ces chroniques ont une dimension profondément critique, exprimée à travers la peinture de la quotidienneté de petites villes néo-grenadines où les tensions politiques, les passions secrètes et souvent libidineuses, les trahisons, la mesquinerie, la médiocrité humaine et la perversité s'épanouissaient jour après jour.
El carnero est la synthèse de différentes copies manuscrites, dont l'exemplaire original a été perdu, et chaque nouvelle copie a apporté sa part de modifications plus ou moins légères, ce qui complique l'explication de texte. Ainsi pendant plus de deux siècles, différentes copies de ces savoureuses chroniques ont circulé clandestinement parmi leurs lecteurs avides, principalement dans les milieux lettrés de Bogotá et Tunja. La critique des fonctionnaires coloniaux y était en effet trop véhémente pour passer le filtre de la censure des autorités royales espagnoles. Et enfin, en 1859, l'homme politique et écrivain colombien Felipe Pérez, dans la toute nouvelle République de Colombie, unifia les différentes versions existantes du texte et en publia la première version imprimée, qui est celle que nous connaissons à notre époque, sous le nom de « El Carnero » (« La peau de mouton »). En effet le titre original était « Conquista y descubrimiento del Nuevo Reino de Granada de las Indias Occidentales del mar Océano y fundación de la ciudad de Santa Fe de Bogotá » (« Conquête et découverte du Nouveau Royaume de Grenade des Indes Occidentales de la mer Océane et fondation de la ville de Santa Fe de Bogotá »). Mais les habitants de Santa Fe ayant pour habitude de couvrir leurs exemplaires avec de la peau de mouton pour en assurer une meilleure conservation, l'oeuvre a fini par être davantage connue sous ce nom que sous son titre original. Aux Archives de Bogotá se trouve une copie de cette première version imprimée de El Carnero en parfait état de conservation, éditée par Felipe Pérez et sortie des presses de l'Imprenta Pizarro y Pérez. Chronologiquement, cette oeuvre est la première du roman national colombien.
Ce livre est donc une chronique historique, mais aussi un bréviaire de sorcellerie, une anthologie de contes picaresques, un pamphlet moraliste contre la corruption du pouvoir et des hommes en général, et une diatribe misogyne écrite par un vieil agriculteur créole pré-voltairien, d'extraction plutôt aisée mais appauvri, dans une petite ville d'altitude des Andes équatoriales nommée Santa Fe de Bogotá.
Il est difficile d'attribuer un genre littéraire précis aux Chroniques du Nouveau Royaume de Grenade, qui en rassemblent et en font confluer plusieurs. Elles sont en effet à l'évidence héritières de la chronique des Indes, dont elles se réclament, ne serait-ce que par leur titre original, ainsi que du roman picaresque. Elles constituent en outre le précurseur du genre dit « roman de la violence », en raison de leurs descriptions minutieuses de meurtres sordides et d'exécutions publiques, genre qui se développa plus tard avec succès en Colombie, grâce notamment à La Vorágine, roman écrit en 1924 par le Colombien José Eustasio Rivera. Avec des histoires telles que celle, entre autres, de la "négresse Juana García", qui assure l'impunité et la tranquillité de riches femmes adultères grâce à des procédés de sorcellerie, on rencontre aussi le genre qui deviendra plus tard le « réalisme magique ». Ce genre a connu son heure de gloire au XXe siècle, notamment grâce au Mexicain Juan Rulfo avec son roman Pedro Páramo (1955) et au Colombien Gabriel García Márquez avec ses Cent ans de solitude (1967). Par de nombreux autres aspects, ces Chroniques ressemblent à un essai philosophique, truffées qu'elles sont de références à la Bible, à la culture classique et à l'Histoire, introduites au gré des rapports plus ou moins proches qu'y voit Rodríguez Freyle avec les anecdotes de son récit, et accompagnées de réflexions morales ou intellectuelles, exprimées tantôt avec ironie, tantôt avec gravité et sur un ton mélodramatique.
Le suspens est entretenu grâce à la narration intercalée, et on assiste alternativement, par exemple, aux actions simultanées des Indiens muiscas en pleine guerre civile et des conquistadors en chemin à travers la jungle pour les conquérir. Sous le commandement de l'Adelantado don Gonzalo Jiménez de Quesada, « naturel de Grenade » en Andalousie, « au cours du [...] carême 1537¹, environ huit cents soldats, avec leurs capitaines et officiers, sur cinq brigantines, initièrent la remontée du río de la Magdalena, avec devant eux un grand labeur et sans guides. Beaucoup de soldats périrent noyés dans le fleuve ; et sur ses rivages il y avait de nombreux Indiens caraïbes, avec lesquels ils eurent de nombreuses guazabaras², dans lesquelles moururent beaucoup d'autres, atteints de flèches empoisonnées ; certains furent dévorés par des caïmans et des tigres³, qui abondent dans le fleuve et les montagnes avoisinantes ; d'autres encore furent mordus par des serpents, et la plupart moururent de maux dus au climat insalubre du mauvais pays » (I).
1 : Le départ de l'expédition de Quesada, de la ville de Santa Marta, eut lieu le 5 avril 1536. On peut citer, entre autres autorités, l'historien néo-grenadin du XVIIe siècle Lucas Fernández Piedrahíta, qui dit : « Ya era entrado por este tiempo el año de trelnta y seis, como dijimos arriba, cuando, según refiere Quesada en el fin del primer capítulo de su compendio historial, a los cinco de abril del año referido salió de Santa Marta siguiendo su derrota por el corazón y centro de la provincia del Chimila hasta dar enlas de Tamalameque » « Était déjà en cours l'année trente-six, comme nous le dîmes plus haut, lorsque, selon ce que réfère Quesada à la fin de son résumé historique, le cinq avril de ladite année il quitta Santa Marta et se mit en chemin à travers le coeur et centre de la province de Chimila jusqu'à atteindre celles de Tamalameque » etc. Historia General de las conquistas del Nuevo Reino de Granada/Histoire Générale des conquêtes du Nouveau Royaume de Grenade (Bogotá —1881). 2 : Cri de guerre des Indiens ; par extension les batailles entre Espagnols et Indiens. 3 : Des jaguars ou pumas, toujours appelés aujourd'hui populairement « tigres » en Colombie.
En dépit de leur forme romancée, les Chroniques du Nouveau Royaume de Grenade présentent un grand intérêt historique, bien que tous les faits narrés ne soient à l'évidence pas à prendre pour argent comptant. Le récit est chronologique et couvre une période allant de 1525, avec la conquête de la province de Santa Marta sur la côte caraïbe, menée par don Rodrigo de Bastidas, jusqu'en 1638, année du centenaire de la conquête de Bogotá, au moment de la prise de fonctions du nouveau président de l'Audience Royale de Santa Fe de Bogotá don Martín de Saavedra y Guzmán et de la suspension du précédent, don Sancho Girón, marquis de Sofraga, dont commence le jugement « de résidence ». Ces derniers événements sont relatés pratiquement en temps réel par l'auteur, alors âgé de soixante-douze ans.
Enfin, ces chroniques présentent aussi un caractère autobiographique, puisqu'on y voit de temps à autre apparaître leur auteur au cours du récit chronologique, comme témoin de certains faits narrés: d'abord enfant, puis adolescent, puis jeune homme, puis adulte, et enfin, vieillard. Rodríguez Freyle commence par nous indiquer sa date de naissance (le 25 avril 1566) au chapitre II. À l'âge de neuf ans il compte parmi les tout premiers témoins de la mort du président de l'Audience Royale, Francisco Briceño. À quinze ans il étudie la grammaire à Bogotá avec son ami Juan de Villardón. Il est alors témoin de troubles politiques entre l'Audience Royale et la Visite (qu'on appellerait aujourd'hui « l'Inspection »), ainsi que de la levée par les autorités judiciaires du cadavre atrocement mutilé d'un homme, retrouvé dans une mare près de « l'école de Ségovie » où lui et ses compagnons étaient alors « en pleine leçon ». Âgé de dix-neuf ans, il embarque en mai 1585 pour l'Espagne depuis le port de Carthagène des Indes. Il y restera six ans. En 1587, à vingt-et-un ans, il est témoin de l'attaque du corsaire anglais Francis Drake sur la ville andalouse de Cadix. En 1591 il revient au Nouveau Royaume de Grenade âgé de vingt-cinq ans, et s'engage dans l'armée, où il participe à la guerre d'extermination des Indiens pijaos. On apprend aussi qu'il se maria vers 1601 dans la cathédrale de Bogotá, tandis qu'il avait environ trente-cinq ans, avec « celle qui est toujours [...] [sa] femme » en 1638, et que l'union fut célébrée par l'archevêque don Bartolomé Lobo Guerrero. Et on sait qu'il survécut à plusieurs épidémies meurtrières, de peste ou de variole, qui décimèrent une grande partie de la population du Nouveau Royaume. Rodríguez Freyle garde toutefois toujours une certaine réserve pudique lorsqu'il parle de lui, et semble ne se convoquer que comme humble témoin de certains faits qu'il relate, pour en fournir une confirmation.
Sur sa famille comme sur lui-même, il ne distribue les informations qu'avec parcimonie. De ses parents on sait qu'ils « furent des premiers conquistadors et résidents¹ de ce Nouveau Royaume» (II) et que son « père fut soldat de Pedro Ursúa -celui qui fut tué plus tard par Lope de Aguirre sur le Marañón [l'Amazone]- » (II). Le cinéma comme la littérature et la bande dessinée ont d'ailleurs rendu hommage aux destins exceptionnels de ces deux aventuriers basques devenus ennemis mortels, notamment le réalisateur allemand Werner Herzog avec le film Aguirre ou la colère de Dieu (1972), et l'écrivain colombien William Ospina avec sa trilogie Ursúa (2005), en grande partie inspirée des présentes Chroniques.
1: résidents: colons.
Rodríguez Freyle affirme avoir « bien connu » le général conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada : « Il fut [...] parrain de baptême d'une de mes soeurs, et compagnon de mes parents. Et mieux eût-il valu que non, pour ce que nous en coûta le second voyage qu'il fit en Castille, duquel il revint obnubilé par l'idée de partir à la recherche de l'Eldorado ; il entreprit donc une expédition pour le trouver, à laquelle participa mon père, en y investissant en pure perte une bonne somme d'argent, bien que certes ils en revinrent tous deux vivants » (VII). On peut soupçonner là une certaine rancoeur de l'auteur envers son père, coupable à ses yeux de l'appauvrissement de sa famille, en engloutissant un capital considérable dans une entreprise insensée. Dans le catalogue A on connaît davantage de détails sur cette expédition infructueuse : « l'Adelantado don Gonzalo Jiménez de Quesada [...] partit à [la] découverte [de l'Eldorado] depuis cette ville de Santa Fe, lorsqu'il revint d'Espagne avec le titre d'Adelantado et trois mille ducats de rente attribués par le Roi, notre seigneur, sur ce qu'il conquerrait. L'effet produit par cette aventure qu'il tenta, fut qu'il perdit tous les gens qui l'accompagnaient, qui moururent de faim ou de maladies, en raison des mauvais climats qu'ils rencontrèrent ; et même sa propre personne se vit fort menacée, mais il fut favorisé, par Dieu premièrement, et ensuite par un morceau de sel qu'il portait pendu à son cou, et grâce auquel il mangeait des herbes qu'il connaissait. Il dut revenir sans avoir trouvé l'Eldorado ni la moindre trace de lui, et avec très peu de soldats ».
On sait donc que Rodríguez Freyle a plusieurs soeurs, dont il tait le nombre et les noms. En revanche on sait que l'une d'elles a épousé un certain « Francisco Antonio de Ocallo, un Napolitain, dont le fils, mien neveu, devint plus tard le père Antonio Bautista de Ocallo, et qui est aujourd'hui curé de la paroisse d'Une et Cueca » (XIV). Il évoque également le passé militaire de ce beau-frère napolitain : « Francisco Antonio, vieux vétéran des campagnes d'Italie, affirmait s'être trouvé présent aux côtés de l'empereur Charles Quint lors de l'expédition d'Alger, qui se solda par une défaite » (XIV).
Comment Juan Rodríguez Freyle définit-il sa propre identité ? Né aux Indes (le mot « Amérique » n'est pas utilisé une seule fois dans le livre) de parents espagnols, il se considère lui-même fièrement comme espagnol, et donc comme catholique, ce qui était alors indissociable, et le revendique clairement : « ont été emportés vers notre Espagne de grands trésors » (prologue). Lors de la guerre opposant le général de Quesada au cacique Bogotá, il se réfère au camp des conquistadors comme aux « nôtres », dont « bien que [le] nombre fût réduit, grands étaient [le] courage et [la] volonté, d'autant plus qu'ils servaient la cause de Dieu N.S » (VI). Mais d'un autre côté il considère l'Espagne comme une « terre étrangère » (XVI) et le Nouveau Royaume de Grenade comme sa « patrie », et exprime une profonde aversion envers la plupart des fonctionnaires coloniaux espagnols, « visiteurs et [...] juges, vermine de ce monde et lie du genre humain » (XIII).
Notre auteur se définit donc comme non-indien, espagnol non-européen mais héritier de la culture européenne et à ce titre fervent chrétien, et enfin comme patriote néo-grenadin : « J'ai voulu tenir ce bref discours pour ne pas être ingrat envers ma patrie, et donner des nouvelles de ce Nouveau Royaume de Grenade, dont je suis naturel » (prologue). La manière dont Rodríguez Freyle définit sa propre identité résume donc assez bien la notion de créolité. Faut-il y voir l'insinuation d'un désir d'indépendance ? Cela est possible, d'autant plus que d'autres éléments viennent renforcer cette hypothèse, malgré les copieuses et abondantes révérences qu'il prodigue à l'endroit du « Roi, notre seigneur ».
Rodríguez Freyle offre une vision nuancée, voire ambiguë, des indigènes : tantôt il justifie la coercition et une certaine violence envers eux, tantôt il la condamne, se montrant plein de compassion et d'humanité à leur égard. Il exprime ainsi sans complexe ses jugements négatifs envers les Indiens : « Aussi ne manquaient-ils point d'être vicieux, d'avoir de nombreuses femmes et de commettre de grands incestes, sans réserver filles ni mères, en conclusion des barbares, sans Loi ni connaissance de Dieu, car ils n'adoraient que le Démon, qu'ils tenaient pour maître, d'où l'on pouvait très clairement déduire qu'ils en étaient les fervents disciples » (II). Il justifie plusieurs fois la violence de la conquête par la nécessité de sauver les âmes de ces « gentils », perdues dans le plus décadent des paganismes et l'adoration « du Diable » : « avant que la parole de Dieu ne pénétrât en ce Royaume, il est fort certain que le Démon y exerçait sa monarchie, qui n'a d'ailleurs pas été totalement destituée, puisque subsistent encore des traces de son règne, particulièrement observables parmi infidèles et gentils, qui ont en défaut la connaissance du Dieu véritable ; et ces naturels demeurèrent en cet aveuglement jusqu'à leur conquête, ce dont le Démon profitait pour se faire adorer par eux comme leur dieu, et pour qu'ils le servissent avec maints rites et cérémonies » (V).
L'auteur insiste plusieurs fois sur l'ampleur de l'extinction des nations indiennes, consécutive à l'arrivée des Espagnols : il parle de « la disparition de la majeure partie [des] naturels » (prologue) du Nouveau Royaume cent ans après la conquête. À propos des Muiscas, indigènes de la région de Bogotá, il narre l'origine ridicule de ce nom qui leur fut attribué par les Espagnols (muisca venant de mosca, c'est-à-dire « mouche » en espagnol), et il annonce une prophétie qui, force est de le constater, s'est réalisée : « ils héritèrent de ce surnom de « mouches », qui ne disparaîtra que longtemps après qu'ils auront eux-mêmes tous disparu ». Effectivement aujourd'hui ce peuple a entièrement disparu, mais on y fait toujours référence sous le nom de « Muiscas ». Rodríguez Freyle évoque aussi les suicides de masse et les épidémies venues d'Europe qui décimèrent en grande partie les populations autochtones. Enfin, il semble conscient du fait que malgré leur évangélisation, la conquête a été très préjudiciable aux populations indigènes : « ces naturels peuvent estimer que leur siècle d'or fut antérieur à la conquête, qu'après elle ils connurent le siècle du fer, et que l'actuel est celui du fer et de l'acier. Et jouissent-ils de l'acier ? Si l'on considère le nombre dérisoire d'entre eux qui ont subsisté en cette juridiction de Santa Fe et dans celle de Tunja, et même ceux-là, pour ce qui est d'en posséder... » (VII). Et il dénonce l'exploitation dont ils sont victimes dans le cadre du système de l'encomienda : « je n'ai pu trouver qui expliquât d'une manière crédible d'où viennent ou descendent ces nations indiennes. Certains prétendirent qu'ils descendaient des Phéniciens et des Carthaginois ; et d'autres encore de cette tribu d'Israël dont on perdit la trace. Il semblerait que ces derniers tiennent là une piste, car leur sort rappelle la prophétie du patriarche sur son fils Issachar, puisque ces nations, ou du moins la majeure partie d'entre elles, servent de bêtes de somme » (VII).
La traduction de ces Chroniques a été réalisée à partir de différentes éditions d'El carnero, et à l'aide de la traduction vers l'anglais du Britannique William C. Atkinson (Conquest of New Granada, 1961). Un paragraphe des Chroniques du Nouveau Royaume de Grenade a même été traduit directement de l'anglais, sans qu'il ait malheureusement été possible de prendre connaissance de cette partie du texte original. Il s'agit, dans le chapitre XIX, du dernier paragraphe relatant la « guerre des Pijaos », et où il est dit que cette campagne guerrière « fit couler plus de sang que l'ensemble de la conquête ». J'ignore en effet de quelle version d'El carnero William C. Atkinson a obtenu ces lignes, mais les informations y étant mentionnées m'ayant semblé importantes, j'ai pris la liberté de traduire ce paragraphe vers le français depuis la version anglaise.
Puissent les lecteurs francophones apprécier la lecture de ces Chroniques, et savourer cette plongée dans les entrailles d'un passé légendaire au parfum d'aventure et de scandale, guidés par un vieil homme enjoué et malicieux. D'autant que Juan Rodríguez Freyle paraît ravi de faire découvrir son univers à ses lecteurs, envers qui il se montre continuellement plein de touchantes attentions, n'hésitant pas à les apostropher directement.
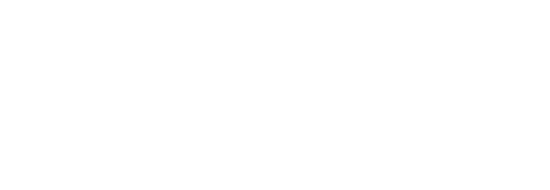
Annotations
Versions