Le syndrome du Caméléon
J’écoutais ce matin Monsieur Emanuele Coccia, philosophe de la métamorphose, passionné par la transformation des corps, dire qu’il se retrouvait dans tout corps, en plus simple, il peut regarder un stylo et affirmer : « c’est moi ! ». En théologie on parlerait d’« âme », en psychanalyse on parlerait du « transfert » et en biologie de « conscience ». Pour les autres, cet homme est juste fou. Pourtant quand Emanuele Coccia dit « je me retrouve dans toute chose » moi ça me parle. Ça me parle tellement que j’en suis toute émue et me vient alors cette pensée : C’est quand même génial de n’être qu’observateur du monde. Depuis toute petite quelque chose me dérange dans la conception même d’individualité. Et voyant le genre de personne que je devenais, le genre de rapport aux autres que je nouais, les personnalités gravitant dans le prisme de mon éducation m’ont parlées d’unicité. Je suis unique par ma vision et mon approche différente. Je m’en serais contentée si je n’avais pas passé les vingt-sept dernières années à jouer les caméléons. Comment peut-on dire de moi que je suis unique si je me retrouve en tout le monde ? Ça n’a pas de sens. Bonjour le syndrome de l’imposteur que cela a fait naître. Il ne faut pas me faire confiance, je ne suis pas celle que tu vois. Je suis qui alors ? Je me suis finalement réconciliée avec mon imposture et j’ai assis fermement ma position d’observatrice du monde. Je ne suis pas tout le monde, j’ai décidé de n’être personne, je regarde, je m’adapte, j’analyse, sans jugement, sans prise de position, sans implication.
Mais cette « non identité » que je pensais m’être propre est en réalité très répandue notamment chez les personnes hypersensibles qui sont ballotées d’un état émotionnel à l’autre constamment et qui se sentent tellement en marge des codes sociaux qu’ils jouent eux aussi les caméléons. Devant cette émergence de gens paumés, un nom acte ce phénomène : Le Syndrome du Caméléon. Beaucoup de gens parfaitement intégrés à la société ont ce « syndrome » comme les bons commerciaux, les comédiens, nouvellement les influenceurs, les consultants diverses. Être un caméléon permet une indépendance quant à son placement sur l’échelle sociale aussi bien d’un point de vue économique que relationnelle. Si l’on a la capacité de s’adapter à tous et à toute situation, l’échelle sociale n’est plus un exercice d’escalade et n’est finalement qu’un ensemble de carrés de bois au sol dans lesquels on saute à pied joint. Seulement pour certain, c’est étroitement lié au sentiment d’imposture et cela représente un tel frein dans la recherche et la constitution de soi qu’ils en deviennent véritablement incapables de se positionner dans le monde. Mais pour autant, être un caméléon représente-t-il vraiment une imposture face à la course à l’authenticité ?
Être authentique, unique mérite une définition. Qui, au-delà des apparences, manifeste l'être le plus vrai, le plus profond, qui reflète la personnalité profonde d'un individu ; Chose unique dont on ne peut trouver d'autres exemples, qu'on ne peut reproduire[1]. Selon la multitude de définitions existantes, beaucoup sont en oppositions. C’est très français d’utiliser un seul mot pour vouloir dire plusieurs trucs contradictoires à la fois. Cependant j’ai noté ceci : Unique est un terme principalement quantitatif et même quand il ne l’est pas, il l’est quand même un peu. C’est une chance unique, il n’y en aura pas d’autre. Authentique est un terme qualitatif. Il n’omet pas l’existence d’un duplicata seulement il est l’original, le brut, le mieux. Il met en avant l’idée d’une vérité universelle sur l’objet auquel il est rattaché.
Dans une société comme la nôtre, être authentique c’est donc être vrai, être soi-même. La petite difficulté c’est qu’en plus il faut être unique. Donc ne ressembler à personne d’autre. Si on n’est pas unique on ne sera jamais reconnu comme authentique. Mais attention être unique ne veut pas dire marginal. Ah non. Marginal c’est trop éloigné de la frontière du normal. Vous vous souvenez de cette expression Rentrer dans le moule ? Peut-être même que certains grandissent encore avec ce mantra éducatif de parents névrosés incapables de faire face à la vie. Mais c’est un autre sujet. Rentrer dans le moule peut vouloir signifier deux choses : Premièrement il y’a un phénomène de transformation d’état. L’état d’entrée dans le moule et l’état de sortie ne peut être le même. Illustration de mes propos par un exemple pertinent : je verse de la pâte à gâteau dans mon moule, deux résultats s’en dégagent, soit avec la cuisson ma pate passe de l’état liquide à l’état solide et il aura pris la forme du moule une fois celui-ci retiré, soit ma pate ne subit aucune transformation d’état et retirer le moule pourrait s’avérer catastrophique. Donc un bon moule n’est utile qu’avec un changement d’état du composant qu’on y met. La seconde hypothèse qui justifierait qu’on puisse entrer dans le moule sans changer d’état supposerait un état initial malléable. Genre pâte à modeler. Aucune transformation n’est faite, simplement une modification de forme. Une fois le moule retiré, la pâte tient la forme du moule et contrairement à la méthode précédente, elle peut entrer dans un autre moule, et encore un autre, et un autre… Les plus fins d’entre vous auront saisi l’analogie. Alors sans avoir besoin de chercher très loin, à votre avis entre la première hypothèse et la seconde, laquelle est la plus rentable ?
Dans un contexte socio-économique de consommation rapide la complexité du travail de construction identitaire résulte de cette particularité. Changer d’état ou se modeler. Le changement d’état apporte une authenticité là où le modelage semble n’être qu’une imposture. Sauf qu’un courant social est mouvant, il évolue à travers les époques, il s’adapte lui-même aux phénomènes culturels et sociales. Le risque est donc de vite passer d’« Authentique » à « Marginal ». Le problème d’un marginal c’est qu’on ne peut que lui attribuer son unicité et son authenticité. Il remplit les cases de la construction aboutit d’une individualité, à tel point qu’il ne correspond plus aux dogmes de la vie en communauté.
L’importance du maintien d’un équilibre entre unicité et intégration sociale est relativement cyclique et semblerait dépendre de la métamorphose des différents contextes socioculturels. Autrement dit, selon l’époque, le contexte historique et les changements sociaux que ça implique, les courants de pensées, les découvertes … nous passons successivement d’une recherche de l’individualité absolue à un besoin d’intégration sociale complète. Le communisme, l’existentialisme, l’humanisme, le romantisme, le socialisme des courants philosophiques et politiques qui portent coup sur coup un changement de positionnement de l’homme au sein d’une société, l’homme au centre de tout, le désir d’abolition hiérarchique et d’égalité sociale, le soi avant les autres, les autres avant le soi etc… Pour pallier à ce conflit de construction identitaire, la société occidentale moderne se sert d’un phénomène social reconnu : Le groupe. On voit alors se dessiner deux idées sociologiques qui s’opposent et se complètent paradoxalement : l’holisme et l’individualisme, misent en avant respectivement par Durkheim et Weber [2]. Je parle ici d’idées sociologiques car il serait un peu laborieux et un poil prétentieux de ma part d’aborder l’influence du groupe sur l’individu et vice versa de façon exhaustive. Pour vulgariser intentionnellement le sujet, on peut dire que l’individualisme serait la mise en avant de l’individu et de son identité ce qui constituerait progressivement un phénomène social (un regroupement) quel qu’il soit alors que l’holisme défend qu’un phénomène social a sa propre identité et que c’est ce dernier qui forge les individus. Alors évidemment il est facile de penser que les deux idées fonctionnent ensemble. Ici nous placerons le besoin d’authenticité dans l’individualisme et le syndrome du caméléon dans les pensées holistiques. Le groupe, disais-je, permet aujourd’hui de mettre en avant les identités de chacun dans la limite du respect de l’identité du groupe lui-même. Par exemple, les personnes à la recherche d’unicité s’orientent vers des emplois à tendance créative, les personnes ayant besoin de faire valoir leur unicité deviennent entrepreneurs, et les caméléons eux deviennent bien souvent l’employé n° 740 d’une boîte plus ou moins grande avec dress-code. La sectorisation de l’emploi est un regroupement de plusieurs phénomènes à la fois économique et sociaux où nous avons tout à chacun notre place sans pour autant être considérés comme marginaux puisque nous faisons partie du système. Cela vaut pour le contexte professionnel mais aussi celui des loisirs, le sport collectif versus le sport individuel, la danse et le théâtre versus la peinture et la musique… L’humain ne peut survire seul, c’est d’ailleurs là-dessus que mise l’essentiel des projets marketing d’aujourd’hui. Chaque produit ou service vendu respecte un ciblage pour rentabiliser la promotion. On ne vend pas un service de soutien scolaire à un jeune couple de vingt ans ou un veuf de quatre-vingt-dix ans. On cible les trente/cinquante ans, avec un enfant à charge minimum, occupant un poste permettant de payer le service mais aussi assez chronophage pour avoir besoin de ce service. Aujourd’hui ce ciblage marketing vise un périmètre plus large que les besoins d’une famille nucléaire classique. « Venez comme vous êtes » ; « Parlons de vous, parlons biens » ; « pour tous ceux que vous êtes » ; « réinventez-vous » et j’en passe. Je viens de citer les phrases marketing connues d’un fast food, d’un réseau immobilier, d’une marque de voiture et d’une marque de vêtements. Elles ont toutes un point commun, elles appuient sur notre authenticité pour vendre plusieurs milliers d’exemplaires d’un même produit. C’est la magie d’une bonne publicité. De ce fait, l’ensemble de ce qui constitue notre quotidien, le travail, les médias, les achats, et même la façon dont est présenté le couple, la famille, l’avenir, tout est encadré par cette idée de mise en avant d’un soi unique et authentique conforme au moule socio-culturel dans lequel on évolue et qui navigue sur la production de masse. Qu’on y adhère ou non ce n’est comme d’habitude qu’une question de choix. Quoi qu’il en soit, axer les communications commerciales vers une acceptation de tous dans leur unicité ne mène évidemment pas à une civilisation bisounours. Le problème étant qu’être authentique et unique est une affirmation identitaire qui se confronte indubitablement au sentiment d’appartenance qui est ancré en nous depuis bien plus longtemps que n’est apparue la conscience de soi. On se retrouve du coup à imposer son identité, son « moi » aux autres afin de prouver notre légitimité à intégrer tel ou tel phénomène social et ainsi éviter le rejet dû à la différence de chacun des individus qui composent le dit phénomène.
A ce stade de réflexion j’en viens à me demander si finalement être authentique et unique ne creuse pas un sentiment de solitude plus fourbe que celui qui habite un caméléon convaincu de n’être qu’une imposture ? On peut distinguer plusieurs types de caméléon. Ceux qui en font un atout professionnel essentiel à une carrière, ceux qui le sont malgré eux sans savoir que c’est une maladie[3] qui n’est alors plus appelée syndrome du caméléon mais syndrome de Zelig, ceux atteint d’un trouble de la personnalité anti-sociale appelé plus couramment « Sociopathe »[4], ceux qui le sont sur une période d’apprentissage particulièrement attendrissante mais limitée c’est-à-dire les enfants, et ceux qui le sont par inconfort identitaire en milieu social. C’est cette dernière catégorie qui m’intéresse car c’est elle qui fait naître un sentiment d’imposture et qui brasse un segment de population plus large. Je connais personnellement beaucoup de personnes se définissant comme tel bien que les représentations ne soient pas toujours celle du caméléon. On entend par exemple souvent parler de « masque », de « jouer un rôle », de « personnalité multiple » tout autant d’analogies d’un même ressenti, celui de ne pas être soi-même. En cela être caméléon se complexifie par une volonté d’affirmation de soi sans vraiment arriver à mettre le doigt sur ce que représente ce fameux « soi ». Savoir qu’on est quelqu’un ne veut pas dire savoir qui on est. C’est un peu comme avoir un air dans la tête dont on connait vaguement les paroles sans jamais réussir ni à les chanter ni à trouver qui en est le compositeur et se retrouver à « meumeumer » pour trouver de l’aide extérieur mais personne ne reconnait l’air. Vous avez déjà ressenti l’énorme frustration engendrée par cette situation ? Multipliez-la à l’échelle de la valeur identitaire d’un individu et vous obtiendrez ce que ressentent les caméléons mal dans leur peau. Le manque d’ancrage identitaire donne naissance à un sentiment de frustration amplifié par un système comparateur, c’est-à-dire un système où l’existence de l’individu n’est confirmée qu’en comparaison à celle d’un autre ou d’autre chose. Si nous étions tous les mêmes la question identitaire ne se serait jamais posée. Cette frustration est un signal émotionnel qui indique un état d’inhibition où l’action nécessaire sur l’environnement pour satisfaire notre cerveau se retrouve parée par l’incapacité de se positionner au sein même de notre environnement[5]. C’est cette inhibition qui est à l’origine du sentiment d’angoisse et dans le cas du caméléon de son sentiment d’imposture. La solitude liée à ce sentiment est singulière car elle n’existe que par une distorsion cognitive, autrement dit, une mauvaise perception de la réalité. L’imposture n’est pas réelle, c’est le sentiment d’imposture qui fausse les récepteurs environnementaux. C’est ainsi qu’un homme très entouré, ayant réussi à s’adapter à une multitude d’individus tous différents se sentira seul puisque l’attention qu’il en retire ne lui semble pas méritée et donc n’apporte aucune libération de dopamine (hormone liée à la réussite) ou d’ocytocine (hormone du lien affectif). Sans libération de ces deux hormones suite à une interaction avec l’environnement social, le cerveau appréhende « l’action » comme un échec et l’enregistre comme une expérience négative qui ne procure aucune satisfaction un peu comme un enfant qui expérimente les doigts sur les plaques de cuisson. Forcément cet échec relationnel confirme le sentiment de non intégration et d’imposture à l’origine de cette réaction ce qui conforte le cerveau dans son idée d’échec et ainsi de suite. Vous faites du vélo et vous avez peur de tomber, donc vous tombez et vous dites « j’avais raison d’avoir peur de tomber puisque je suis tombé ». Quand vous remontez sur le vélo, fort de l’expérience que vous venez de vivre vous avez deux fois plus peur de tomber, donc vous tombez…
Par conséquent le sentiment de solitude émane de l’individu lui-même et n’est pas un rejet de l’environnement social contrairement au sentiment de solitude qui peut apparaitre chez une personnalité marquée par l’authenticité. Si avoir une identité aboutie signifie imposer son soi et tenter par la suite de trouver un groupement avec des valeurs communes, alors un rejet du groupe est un ébranlement total de l’identité. Mais comme l’humain est doté d’un égo et d’une faculté de déni bien élaborée, il faut des mois parfois des années avant de se rendre compte que l’on avance dans la vie avec des miettes de son ancien soi.
Je vais peut-être revenir un peu sur la notion de rejet qui est à la genèse de bon nombre de névroses sociales et affectives dans la vie d’un adulte. En psychologie le rejet est perçu comme l’une des blessures les plus profondes de l’enfance. En sociologie l’ostracisme est une exclusion délibérée mandaté par un regroupement et donc souvent attribuée à « l’effet de groupe ». Il y a dans la sémantique du mot « rejet » une notion de déplacement. On pousse quelque chose en dehors de ce qui est délimité, l’objet rejeté ne commet aucune autre action que celle d’être en mouvement, il subit simplement l’action et ne peut la contrer. Jetez un objet inanimé au loin il y a peu de chance qu’il fasse pression de lui-même pour ne pas bouger. Le sentiment de rejet nous transforme le temps de l’action en objet inanimé. Un fois de plus on entre dans un conflit entre besoin d’agir, de garder un contrôle sur notre environnement et inhibition complète de l’action. Mais contrairement à une distorsion de la réalité, le rejet lui est bien réel. Quand Sabrina dit à Paul « c’est fini entre nous, je ne t’aime plus » il est sérieusement déconseillé de mettre ça sur le compte d’une déformation subjective et Paul ferait mieux d’éviter de se dire « C’est que dans ma tête, elle m’aime encore et ne m’a pas quitté. Je vais aller escalader son balcon pour lui prouver mon amour elle sera contente » sinon Paul finira à l’asile. La réaction la plus saine c’est donc d’accepter qu’on vienne de se faire rejeter.
Une fois qu’on comprend qu’on est rejeté, la mise en place de carences affectives et de traumatismes psychologiques s’effectue. Outre le fait que cela ramène inévitablement à l’enfance, au cordon affectif parental, aux premiers amours ratés et notre première soirée en boîte passée sur le trottoir d’en face parce qu’on portait des baskets, le rejet social remet en question notre construction identitaire par le simple fait qu’en théorie il n’y a aucune raison d’être rejeté. L’authenticité d’une personnalité se rapproche plus de la notion valeur que d’un critère identitaire. Or pour faire partie d’un groupe social qu’il soit restreint, professionnel, ou culturel, il faut avoir au minima une valeur commune. Donc un regroupement de gens authentiques et uniques ce n’est ni plus ni moins qu’un groupement de gens dont la valeur commune est « moi ». Le rejet est effectif quand ton « moi » n’est pas au gout d’un autre « moi » plus élevé hiérarchiquement au sein du groupe ou pire si ton « moi » est refusé par une majorité d’autres « moi » qui ont comme valeur commune de ne pas accepter la tienne. Mindfuck. Concrètement le rejet social est une des plus anciennes punitions sous entendant que la personne rejetée a fait une faute grave. C’est le regroupement qui a permis aux premiers hommes de survivre, de développer l’élevage, l’agriculture, la sédentarité et très rapidement la notion de culte. Être exclu du groupement signifiait la mort. Certes, c’est un peu radical. Pourtant scientifiquement c’est irréfutable, les chances de survit en milieu hostile lorsqu’on est un exclu sont quasi nulles. Ce que je dis là n’est finalement rien d’autre que du darwinisme[6] et donc comme dirait ma mère la science n’est qu’une croyance comme une autre, mais pour reprendre l’argument de notre paléontologue américain préféré : « Sans l’évolution, comment expliques-tu les pouces opposables ? »[7]. Et quand on est face à la possibilité de se faire rejeter pour son « moi » par un groupe, quel est la solution ? Reconstruire son identité et chercher à nouveau sa place quelque part ou adapter son moi pour éviter le rejet ? Est-ce que ce ne serait pas un peu « faire son caméléon » ?
Lorsqu’Emmanuel Coccia parle de philosophie de la métamorphose, il dit se retrouver dans tout corps. C’est là l’entière liberté d’un penseur, il devient le Tout d’un monde. A mon sens cela rejoint ma position d’ « observateur du monde ». Je pense que l’imposture n’a pas lieu d’être lorsqu’on est un caméléon. Le caméléon n’est pas rien. C’est un animal, il fait partie des être vivants, il a sa classification, il a un genre, et chaque caméléon est unique selon les lois de la nature et de la biologie. Il ne devient pas un tout non plus, il a son unicité et s’accorde, se fond dans un tout. Donc lorsque les spécialistes du développement personnel écrivent un article intitulé « Cessez d’être un Caméléon soyez quelqu’un ! » c’est à la fois très vexant pour ces petites bestioles tellement peu considérées mais aussi complètement anxiogène pour les personnalités dites du caméléon.
Être caméléon ou bien « observateur du monde » c’est avant tout être doté d’une sensibilité à tel point affinée que l’entièreté de ce qui compose la vie nous concerne directement. Comme dans tout ce qui fonde une personnalité, il est ensuite question de dosage, savoir faire la part des choses entre ce qui nous importe presque de façon intuitive et ce qui est simplement intéressant à observer. Garder par exemple une sensibilité exacerbée en ce qui concerne les enfants et les animaux mais faire preuve d’une distance émotionnelle et affective à la limite de la sociopathie lorsqu’il s’agit de l’homme adulte. Tout rapprochement de cet exemple avec une personne de votre entourage est fortuit.
En définitive, du fait de sa capacité d’adaptation et compte tenu de la vitesse à laquelle évolue nos fonctionnements sociaux, la recherche d’authenticité ne m’apparaît pas être le bon choix de survie, bien au contraire il me semble de plus en plus clair qu’un besoin constant de valorisation par l’unique participe amplement à la fragilisation affective et identitaire de nos générations occidentales.
[1] Définitions Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales
[2] Emile Durkheim, De la division du travail social Paris (1893) et Marx Weber L'Éthique protestante et l'Esprit du capitalisme (1904-1905)
[3] Conchiglia G. et al. (2007). On a peculiar environmental dependency syndrome in a case with frontal-temporal damage : Zelig-like syndrome. Neurocase, 13 (1) : 1-5.
[4] Association américaine de psychiatrie, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV-TR), 4e, 2000, p. 645–650.
[5] H.LABORIT “Action et réaction. Mécanisme bio-et neurophysiologiques » Agressologie (1974)
[6] Thomas Henry Huxley, Man’s place in nature, Londres, Williams & Norgate et Paris, Baillière, 1868
[7] Friends, épisode 3 saison 2
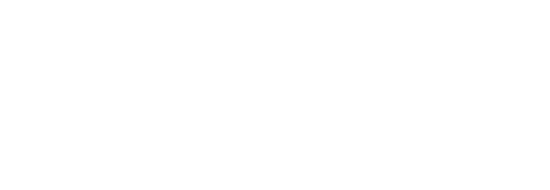
Annotations